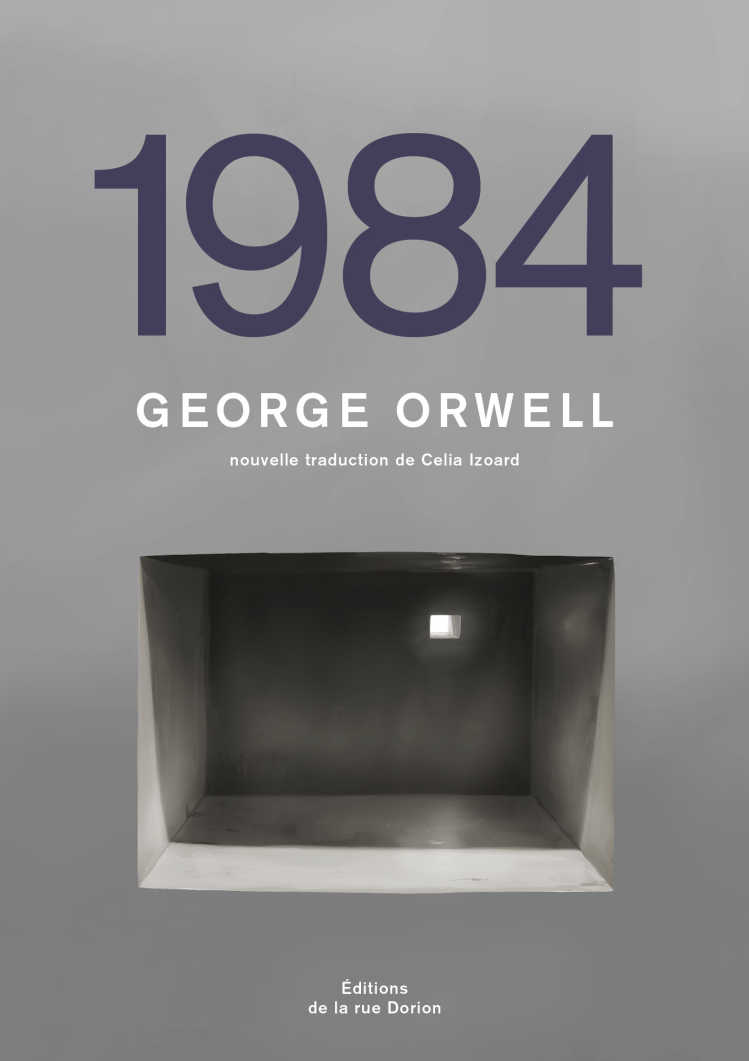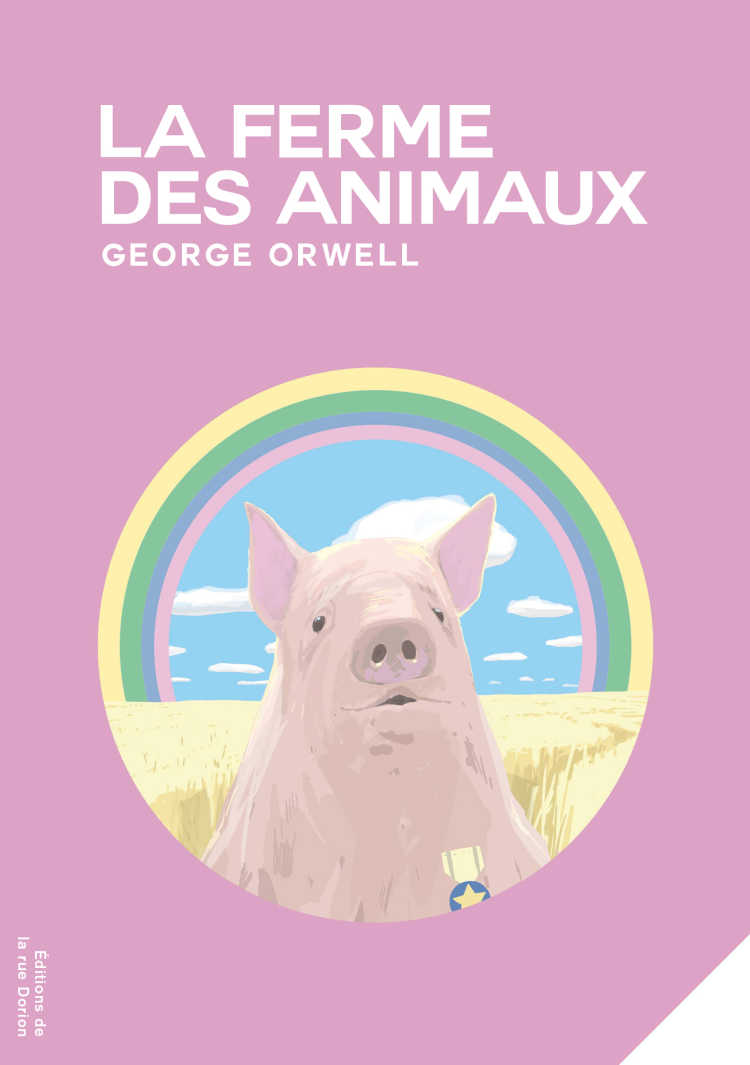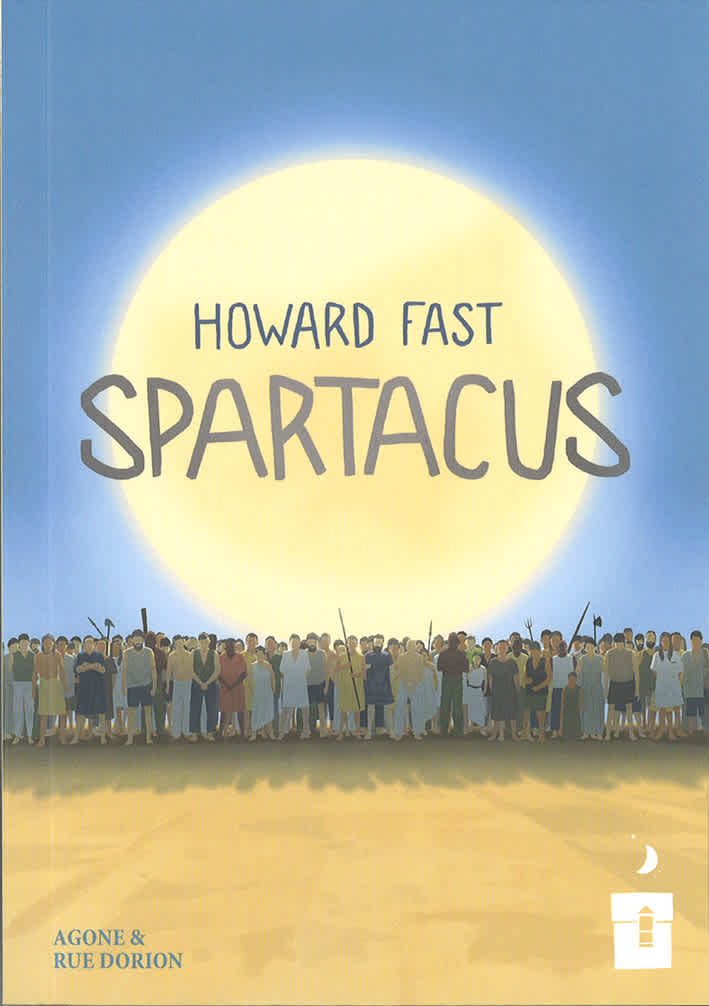Celia Izoard est philosophe de formation. Franco-Anglaise, elle travaille comme journaliste dans l’équipe de la revue de critique sociale Z et a coécrit plusieurs ouvrages critiques des nouvelles technologies. Ses travaux pointent le fait que les nouvelles technologies qui déferlent sur notre quotidien font disparaître, non seulement la liberté, mais aussi le désir de liberté, et nous rendent de plus en plus dépendants, jusque dans notre intimité profonde, des grandes entreprises et d’un appareil industriel totalement délirant. Celia Izoard a traduit plusieurs livres sur ces mêmes sujets, dont celui de l’historien David Noble, Le progrès sans le peuple, également paru aux Éditions de la rue Dorion. Elle galement traduit Howard Zinn et Noam Chomsky.
![1984]()
George Orwell
Édition établie par Claude Rioux et Thierry Discepolo
Postface de Celia Izoard et Thierry Discepolo
Nouvelle traduction de Celia Izoard
512 pages
Parution le 23 janvier 2019
Format Format poche (17 x 12 cm)
ISBN : 978-2-924834-01-5
Prix : 21.95 $
--- Format e-pub ---
ISBN : 978-2-924834-02-2
Prix : 14.99 $
- Acheter sur le pressier
1984
« Novlangue », « police de la pensée », « Big Brother »… Soixante-dix ans après la publication du roman d’anticipation de George Orwell, les concepts clés de 1984 sont devenus des références essentielles pour comprendre les ressorts totalitaires de la société actuelle. Dans un monde où la télésurveillance s’est généralisée, où la numérisation a donné un élan sans précédent au pouvoir et à l’arbitraire des administrations, où le passé tend à se dissoudre dans l’éternel présent de l’innovation, le chef-d’œuvre d’Orwell est à redécouvrir dans une nouvelle traduction et une édition critique.
En 1984, dans la mégapole tentaculaire d’une superpuissance mondiale, Winston Smith vit, comme les autres membres du Parti, « cadenassé dans sa solitude » sous le regard constant du télécran et de Big Brother. Petit employé de bureau, il se rend chaque jour au ministère de la Vérité, dont la tâche est de lisser le réel par de nouveaux mots de novlangue et d’expurger les archives pour en gommer toute contradiction avec la ligne officielle du moment. Mais quand Winston parvient à se fermer quelques instants aux sollicitations incessantes du télécran, sa sensibilité lui souffle que le monde, un jour, a dû être différent. Dans les interstices de cette société quadrillée, il commence un journal, tombe amoureux et flâne dans les quartiers des proles où subsistent encore quelques fragments du passé aboli…
Cette nouvelle traduction corrige les lacunes de la version réimprimée à l’identique depuis 1950 (une quarantaine de phrases manquantes et de nombreux contresens). Au contraire de la traduction « moderne » parue chez Gallimard en 2018, nous respectons la temporalité d’origine du récit et restituons la dimension philosophique et la fulgurance politique du roman d’Orwell dans les termes que des millions de lecteurs se sont appropriés depuis un demi-siècle, tout en rendant hommage à la dimension poétique de cette œuvre pleine d’humour, d’amertume et de nostalgie.
C’était un jour d’avril froid et lumineux, et les horloges sonnaient 13:00. Winston Smith, qui avançait le menton rentré dans le cou pour tenter d’échapper au vent mauvais, franchit rapidement les portes vitrées des demeures de la Victoire, pas assez vite cependant pour empêcher un tourbillon de poussière gravillonneuse de s’engouffrer avec lui.
Le hall d’entrée sentait le chou bouilli et la vieille carpette. À l’une de ses extrémités, une affiche en couleurs, de proportions démesurées pour l’intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d’un mètre : celui d’un homme d’environ quarante-cinq ans à la moustache noire fournie et aux beaux traits vigoureux. Winston se dirigea aussitôt vers l’escalier. Inutile d’essayer l’ascenseur. Même pendant les périodes fastes, il fonctionnait rarement, et le courant électrique était désormais coupé pendant la journée – une des mesures d’économie adoptées en prévision de la semaine de la haine. Son appartement se trouvait au septième étage et Winston, qui avait trente-neuf ans et un ulcère variqueux à la cheville droite, monta lentement en s’arrêtant plusieurs fois pour se reposer. Sur chaque palier, face à la cage d’ascenseur, le visage géant de l’affiche le scrutait depuis le mur. C’était un de ces portraits qui donnent l’impression de vous suivre constamment des yeux. Au bas de l’image, on pouvait lire « Big Brother vous regarde ».
Dans l’appartement, une voix sirupeuse débitait une série de chiffres concernant, apparemment, la production de fonte. Elle sortait d’une plaque de métal rectangulaire semblable à un miroir sans tain qui formait une partie du mur de droite. Winston actionna un interrupteur et la voix passa en sourdine, même si les mots restaient audibles. On pouvait baisser le son de l’appareil (qu’on appelait « télécran ») mais pas l’éteindre complètement. Il s’avança vers la fenêtre : silhouette grêle d’un homme plutôt petit, vêtu d’une combinaison bleue – l’uniforme du parti – qui soulignait sa maigreur. Ses cheveux étaient très clairs, son visage naturellement sanguin, sa peau rendue rêche par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l’hiver qui venait de finir.
Dehors, même à travers la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. En bas, dans la rue, de petits tourbillons de vent entraînaient des spirales de poussière et de papiers déchirés, et malgré le soleil éclatant et le ciel d’un bleu dur, tout semblait décoloré à l’exception des affiches placardées un peu partout. Le visage à la moustache noire vous surplombait du regard à chaque angle stratégique. Il y en avait un sur la façade juste en face. « Big Brother vous regarde », disait la légende, et les yeux sombres s’enfonçaient dans ceux de Winston. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche, déchirée d’un côté, battait à chaque rafale, couvrant et découvrant alternativement le seul mot « angsoc ». Dans le lointain, un hélicoptère glissa à basse altitude entre les toits, s’immobilisa un instant comme une mouche bleue et repartit en flèche dans un vol incurvé. C’était la police qui épiait aux fenêtres des gens. Cela dit, les patrouilles n’avaient pas d’importance. Seule la police de la pensée était vraiment dangereuse.
Dans le dos de Winston, le télécran continuait son mitraillage de commentaires sur la fonte et la production record du IXe Plan triennal. Le télécran servait simultanément de récepteur et d’émetteur. Il enregistrait dès qu’on émettait un son plus élevé qu’un murmure très bas, et tant qu’on se trouvait dans le champ de vision de la plaque de métal, on pouvait être à la fois écouté et regardé. Bien sûr, il n’y avait aucun moyen de savoir si on était observé à tel ou tel moment. À quelle fréquence et selon quelle règle la police de la pensée se branchait sur un réseau individuel, on ne pouvait que le deviner. Il était même possible qu’elle surveille chacun en permanence. En tous cas, elle pouvait se connecter sur votre réseau à tout moment. On devait vivre, on vivait – par une habitude qui s’était muée en instinct – en partant du principe que le moindre son était écouté et, hormis dans l’obscurité, le moindre mouvement épié.
Winston tournait toujours le dos au télécran. C’était plus sûr – même si, il le savait bien, un dos peut en dire long. À un kilomètre de là, le ministère de la Vérité, où il travaillait, dominait de sa haute tour blanche le paysage cendreux. Et voilà, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût, voilà Londres, capitale de la Zone aérienne Un, Londres qui formait à elle seule la troisième province la plus peuplée d’Océanie. Il chercha dans sa mémoire un souvenir d’enfance qui lui indiquerait si la ville avait toujours ressemblé à ça. Avaient-ils toujours été là, ces alignements de maisons XIXe vermoulues, avec leurs pignons étayés par des poutres, leurs fenêtres colmatées par du carton, leurs toitures couvertes de tôle ondulée et leurs murets de jardins bringuebalant follement dans toutes les directions ? Et ces endroits bombardés où la poussière de plâtre soufflait en spirales, où l’épilobe grimpait sur les tas de décombres ? Et ces zones où les bombes avaient dégagé des surfaces plus vastes, sur lesquelles avaient poussé des colonies sordides de cabanes en bois, semblables à des cages à lapins ? Inutile, Winston ne se rappelait pas. Il ne lui restait de son enfance qu’une série de tableaux brillamment illuminés, sans arrière-plan et pour la plupart incompréhensibles.
Le ministère de la Vérité – Vérigouv, en novlangue – tranchait nettement avec tout autre bâtiment visible alentour. C’était une énorme pyramide de béton d’un blanc éclatant dont la structure à gradins culminait à trois cents mètres de haut. De son poste d’observation, Winston parvenait tout juste à déchiffrer les trois slogans du parti gravés en lettrage élégant sur la façade blanche :
LA GUERRE, C’EST LA PAIX LA LIBERTÉ, C’EST L’ESCLAVAGE L’IGNORANCE, C’EST LA FORCE
Notre traduction de 1984, qui vient d’arriver en librairies, est née de l’édition par Jean-Jacques Rosat des livres d’Orwell et sur Orwell qu’il a souvent préfacés et parfois traduits pour la collection « Banc d’essais » qu’il a dirigée aux éditions Agone. La lecture de ces « réflexions » livre donc le cadre philosophique et politique de notre projet.
Dans un texte de l’été 1946 (l’époque où il s’engage dans la rédaction de 1984), intitulé Pourquoi j’écris, Orwell déclare : « Ce à quoi je me suis attaché le plus au cours de ces dix dernières années, c’est à faire de l’écriture politique un art (to make political writing into an art).[1] » Un romancier qui travaille ainsi à réunir dans une même œuvre l’art et la politique s’expose à l’accusation de trahir son art, de trahir le roman. Dans Les testaments trahis, Milan Kundera oppose Kafka, le romancier véritable, à Orwell, le faux romancier. Il écrit à propos de 1984 :
Roman ? Une pensée politique déguisée en roman ; la pensée, certes lucide et juste mais déformée par son déguisement romanesque qui la rend inexacte et approximative. Si la forme romanesque obscurcit la pensée d’Orwell, lui donne-t-elle quelque chose en retour ? Éclaire-t-elle le mystère des situations humaines auxquelles n’ont accès ni la sociologie ni la politologie. Non : les situations et les personnages y sont d’une platitude d’affiche. Est-elle donc justifiée au moins en tant que vulgarisation de bonnes idées ? Non plus. Car les idées mises en roman n’agissent plus comme idées mais comme roman, et dans le cas de 1984 elles agissent en tant que mauvais roman avec toute l’influence néfaste qu’un mauvais roman peut exercer.
L’influence néfaste du roman d’Orwell réside dans l’implacable réduction d’une réalité à son aspect purement politique et dans la réduction de ce même aspect à ce qu’il a d’exemplairement négatif. Je refuse de pardonner cette réduction sous prétexte qu’elle était utile comme propagande dans la lutte contre le mal totalitaire. Car le mal, c’est précisément la réduction de la vie à la politique et de la politique à la propagande. Ainsi le roman d’Orwell, malgré ses intentions, fait lui-même partie de l’esprit totalitaire, de l’esprit de propagande. Il réduit (et apprend à réduire) la vie d’une société haïe en la simple énumération de ses crimes[1].
L’argumentation de Kundera repose sur l’idée que ce roman ne nous apprendrait rien sur le totalitarisme qu’un livre de sociologie ou de politologie ne pourrait nous apprendre. Il ne serait que « la mise en roman » d’idées conçues indépendamment de lui et communicables par d’autres voies. Il ne serait donc qu’une œuvre de propagande, participant, en dépit de ses bonnes intentions, de l’esprit du totalitarisme qu’il prétend combattre, puisque celui-ci précisément réduit toute forme d’art à de la propagande.
Je voudrais essayer de montrer que ce jugement est faux. 1984 produit sur le totalitarisme un genre de connaissance que seul un roman peut produire et transmettre, une connaissance qui n’est ni historique ni sociologique ni même philosophique, mais une connaissance morale ou pratique, une connaissance non théorique et qui ne fait appel à aucune forme de théorie.
Mais d’abord, quel genre de roman est 1984 ?
1. Quel genre de roman est 1984 ?
La réponse à cette question ne va pas de soi. C’est un roman d’anticipation, sans doute, mais qui combine d’une manière toute à fait singulière l’esprit de la satire philosophique du xviiie siècle, les procédés rudimentaires du roman gothique du xixe et les techniques sophistiquées des romans du courant de conscience de la première moitié du xxe. Ce caractère hybride n’est sans doute pas étranger à son discrédit auprès de critiques littéraires et de romanciers qui ont les exigences de Kundera, mais il est certainement la source de l’atmosphère très particulière dans laquelle baigne le roman, de ce mélange de réalisme sordide et de conte magique, de parodie grimaçante, de fragments de rêves et de dialogues philosophico-politiques – une ambiance qui n’est vraisemblablement pas étrangère à l’immense succès populaire de cette œuvre : en un demi-siècle, 1984 et La ferme des animaux se sont vendus à plus de 40 millions d’exemplaires.
1984 est d’abord, comme le souligne son titre, un roman d’anticipation. Publié en 1949, il raconte une histoire qui est censée se dérouler trente-cinq ans plus tard. Il décrit donc une société fictive, une société qui n’existe pas ou, du moins, n’a encore jamais existé. Dans un roman d’anticipation, en effet, ce ne sont pas seulement les personnages et les événements qui, comme dans tous les autres romans, sont fictifs, mais également la société tout entière où ils prennent place : les formes d’organisation sociale et politique, les techniques, les mœurs, les valeurs, les normes, les croyances, etc., y sont toutes fictives. Les romans d’anticipation nous forcent à imaginer de quelle manière, un jour, des hommes pourraient vivre. Ils enrichissent ainsi le large éventail des sociétés humaines de nouveaux exemplaires qui, à la différence de ceux que nous décrivent les historiens ou les ethnographes, sont des exemplaires fictifs.
La société de I984 est une société totalitaire accomplie, une société intégralement totalitaire ; mais c’est une société originale et singulière. Ce n’est pas une société déjà existante (la société soviétique par exemple) présentée sous un déguisement romanesque : 1984 n’est pas un roman à clé. Mais, bien que fictive, cette société n’est pas pour autant non plus une abstraction : le régime totalitaire de 1984 n’est pas, comme on le dit souvent, un idéal-type abstraitement reconstruit à partir d’une combinaison de traits des systèmes communiste et nazi. Il a des caractéristiques qui le distinguent de tous les autres régimes totalitaires. Par exemple, à la différence des régimes communistes et nazis, il ne cherche aucune expansion ni territoriale ni idéologique, et il est inséparable d’un système géopolitique mondial stable de trois empires, également totalitaires, qui sont en guerre permanente entre eux mais sans avoir ni les moyens ni la volonté de s’envahir ou de se détruire[3]. Pour prendre un autre exemple, les prolétaires, qui constituent 85% de la population, sont considérés comme des sous-hommes ; mais, pourvu qu’ils s’épuisent au travail et consomment le moins possible, le régime se désintéresse de leurs vies et de leurs pensées, et il ne les soumet pas au contrôle total et permanent qu’il fait peser sur les membres du Parti.
Le Parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels, qui devaient être tenus en état de dépendance, comme les animaux, par l’application de quelques règles simples. Laissés à eux-mêmes comme le bétail dans les plaines de l’Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel selon une sorte de canon ancestral. […] On n’essayait pas de les endoctriner avec l’idéologie du Parti. Il n’était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu’on leur demandait, c’était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu’il était nécessaire de leur faire accepter plus d’heures de travail ou des rations plus réduites. […] La plupart des prolétaires n’avaient même pas de télécran chez eux. […] Ils étaient au-dessous de toute suspicion. Comme l’exprimait le slogan du Parti : « Les prolétaires comme les animaux sont libres.[4] »
On conviendra qu’il est impossible d’appliquer cette description au prolétariat soviétique de l’époque stalinienne. James Conant a raison de voir là un argument contre ceux qui, comme Richard Rorty et, semble-t-il aussi, Milan Kundera, veulent faire des deux premières parties de 1984 une redescription du communisme soviétique. Bien entendu, le régime de 1984 a beaucoup de traits communs avec le régime stalinien, à commencer par la moustache de Big Brother et la barbiche de Goldstein, l’ancien dirigeant que la propagande a transformé en un traître immonde. Mais 1984 n’est pas comme La ferme des animaux une fable allégorique dont chaque épisode a son parallèle dans l’histoire du régime bolchevique.
Certes, l’État de 1984 est un État totalitaire typique, qui partage avec la plupart des régimes totalitaires du xxe siècle une série de traits caractéristiques : police politique, disparitions, torture systématique, exécutions sans jugement, purges, camps, tout l’appareil de la terreur de masse permanente y est présent. Mais la description de ces instruments occupe très peu de place, et certains d’entre eux (les camps notamment) sont seulement mentionnés. Le roman tient leur existence pour acquise : dans un tel régime, elle va de soi. Ce qu’il décrit longuement, en revanche, ce sont les transformations des cadres sociaux, culturels et psychologiques de la pensée :
– l’effet sur les esprits de la surveillance constante par les caméras cachées des télécrans ;
– l’appauvrissement et l’uniformisation du langage par la destruction des mots et l’imposition du novlangue ;
– la modification permanente de l’histoire et des mémoires par l’élimination de toute trace du passé et la rectification permanente des archives ;
– la répression de toute expression, si minime soit-elle, d’une émotion authentique ou spontanée ;
– la diffusion par la propagande d’un flot d’informations et de statistiques qui ne sont pas seulement des déformations de la réalité mais n’entretiennent plus aucune sorte de rapport avec elle ;
– la mise en place de mécanismes de formation des croyances dans lesquels ni la perception de la réalité ni l’évidence rationnelle ne jouent plus aucun rôle, et pour lesquels le seul critère est la conformité au dogme politique du jour.
Bien entendu, Orwell n’a pas inventé ces transformations : à chaque nouvelle édition du manuel d’histoire du PCUS, des dirigeants de longue date disparaissaient des photos et devenaient des traîtres stipendiés ; la corruption de la langue allemande par le nazisme a été magistralement décrite et analysée par Victor Klemperer dans LTI. La langue du 3ème Reich [5] ; et les militants communistes, qui pensaient être ennemis des nazis, ont dû croire un matin d’août 39 qu’ils étaient en réalité leurs amis, puis, un beau matin de juin 41, qu’ils en étaient les plus grands ennemis et l’avaient toujours été. Mais, dans le monde de 1984, la logique de ces transformations est poussée jusqu’à l’extrême le plus absurde, selon un principe de grossissement et de caricature qui est celui de la satire swiftienne : les numéros anciens du Times sont quotidiennement falsifiés et réécrits en conformité avec la ligne politique du jour ; l’ultime version du novlangue simplifiera et mécanisera l’anglais à un point tel qu’aucun texte classique ne pourra plus être compris ni même traduit ; en plein milieu de manifestations populaires de soutien à la guerre contre l’Eurasie, on déclare soudain que c’est contre l’Estasie qu’on est en guerre depuis des années alors que l’Eurasie a toujours été un allié fidèle, et tout le monde non seulement le croit sur le champ, mais croit qu’il l’a toujours cru et oublie qu’une minute avant il croyait autre chose, etc. Que cette satire ne fasse pas rire et soit plutôt faite pour donner des cauchemars ne l’empêche pas d’être, typiquement et fondamentalement, une satire.
Dans une lettre datée du 26 décembre 1948, Orwell explique qu’il a voulu dans son livre « montrer en les parodiant les implications intellectuelles du totalitarisme[6] ». Comme le souligne avec force James Conant, la caractéristique nouvelle et terrifiante des régimes totalitaires du xxe siècle ne consiste pas tant, pour Orwell, dans leurs instruments de terreur que dans les stratégies intellectuelles et psychologiques au moyen desquelles ils essaient de « parvenir à un contrôle total de la pensée, de l’action et de sentiments humains ». Tel qu’Orwell l’emploie,
le terme « totalitarisme » désigne des stratégies (à la fois pratiques et intellectuelles) […] qui sont appelées ainsi parce qu’elles ont pour but de parvenir à un contrôle total de la pensée, de l’action et de sentiments humains. L’usage orwellien de ce terme ne recouvre pas seulement des formes de régimes politiques, mais aussi des types de pratiques et d’institutions plus envahissantes et plus spécifiques (diverses pratiques journalistiques comptent au nombre de ses exemples favoris). Mais par-dessus tout, il applique ce terme aux idées des intellectuels – et pas seulement à celles qui ont cours dans […] les « pays totalitaires » [7].
Du point de vue d’Orwell, explique encore Conant,
les camps de concentration et les forces de la police secrète sont périphériques par rapport à l’ensemble des phénomènes culturels, sociaux et politiques qu’il se propose d’identifier comme totalitaires. Le noyau en est constitué par un sorte de « mensonge organisé » qui, si les conséquences logiques de ses tendances profondes étaient poussées jusqu’au bout, serait reconnu comme « l’exigence de ne plus croire dans l’existence même de la vérité objective[8] ». C’est cela qui, pour Orwell, fait véritablement du totalitarisme l’ennemi du libéralisme [9].
Il est essentiel ici de faire observer que ces processus intellectuels et mentaux existent aussi à l’extérieur des régimes totalitaires. Conant cite à ce sujet une autre lettre d’Orwell, datée du 16 juin 1949 :
Je crois […] que les idées totalitaires ont pris partout racine dans les esprits d’intellectuels, et j’ai essayé de pousser ces idées dans toutes leurs conséquences logiques. L’action est située en Grande-Bretagne pour souligner que les races anglophones ne valent pas mieux par naissance que n’importe quelle autre, et que le totalitarisme, si on ne le combat pas, pourrait triompher n’importe où[10].
C’est d’ailleurs en Angleterre, dans la presse de gauche où il écrit, et dans les milieux d’intellectuels de gauche et d’extrême gauche où il vit, qu’Orwell s’y est heurté pour la première fois. En 1937, en effet, de retour d’Espagne après avoir combattu le fascisme dans la milice du POUM et après avoir dû s’enfuir pour échapper d’extrême justesse à son arrestation par les communistes, il est abasourdi par la manière dont la presse de gauche anglaise rend compte des événements espagnols et par le degré auquel les intellectuels de gauche ne veulent rien savoir de la liquidation systématique des anarchistes et des militants du POUM par les staliniens. Voici comment, dans ses « Réflexions sur la guerre d’Espagne » écrites cinq ans plus tard, en 1942, à Londres et sous les bombes allemandes, il évoque sa prise de conscience de ce qui est pour lui le trait essentiel, totalement neuf et totalement terrifiant, du totalitarisme :
Tôt dans ma vie, je m’étais aperçu qu’un journal ne rapporte jamais correctement aucun événement, mais en Espagne, pour la première fois, j’ai vu rapporter dans les journaux des choses qui n’avaient plus rien à voir avec les faits, pas même le genre de relation que suppose un mensonge ordinaire. J’ai vu rapporter de grandes batailles là où aucun combat n’avait eu lieu et un complet silence là où des centaines d’hommes avaient été tués. […] J’ai vu les journaux de Londres débiter ces mensonges et des intellectuels zélés bâtir des constructions émotionnelles sur des événements qui n’avaient jamais eu lieu. J’ai vu, en fait, l’histoire s’écrire non pas en fonction de ce qui s’était passé, mais en fonction de ce qui aurait dû se passer selon les diverses “lignes de parti”. […] Ce genre de chose m’effraie, car il me donne souvent le sentiment que le concept même de vérité objective est en voie de disparaître du monde. […] Je suis prêt à croire que l’histoire est la plupart du temps inexacte et déformée, mais, ce qui est propre à notre époque, c’est l’abandon de l’idée que l’histoire pourrait être écrite de façon véridique. Dans le passé, les gens mentaient délibérément, coloraient inconsciemment ce qu’ils écrivaient, ou cherchaient la vérité à grand-peine, tout en sachant bien qu’ils commettraient inévitablement un certain nombre d’erreurs. Mais, dans tous les cas, ils croyaient que les “faits” existent, et qu’on peut plus ou moins les découvrir. Et, dans la pratique, il y avait toujours tout un ensemble de faits sur lesquels à peu près tout le monde pouvait s’accorder. Si vous regardez l’histoire de la dernière guerre [la Première Guerre mondiale], dans l’Encyclopedia Britannica par exemple, vous vous apercevrez qu’une bonne partie des données sont empruntées à des sources allemandes. Un historien allemand et un historien anglais seront en profond désaccord sur bien des points, et même sur des points fondamentaux, mais il y aura toujours cet ensemble de faits neutres, pourrait-on dire, à propos desquels aucun des deux ne contestera sérieusement ce que dit l’autre. C’est précisément cette base d’accord […] que détruit le totalitarisme. […] L’objectif qu’implique cette ligne de pensée est un monde de cauchemar où le Chef, ou une clique dirigeante, ne contrôle pas seulement l’avenir, mais aussi le passé. Si le Chef dit de tel ou tel événement “cela n’a jamais eu lieu” — eh bien, cela n’a jamais eu lieu. S’il dit que deux et deux font cinq – eh bien, deux et deux font cinq. Cette perspective me terrifie beaucoup plus que les bombes – et après ce que ce que nous avons vécu ces dernières années, ce ne sont pas là des propos en l’air[11].
Sept ans avant 1984, Orwell donne ici sa définition de l’univers totalitaire : un monde où, si on l’exige de vous, vous devez pouvoir croire que 2 et 2 font 5.
1984 constitue-t-il pour autant, comme on le prétend souvent, une anti-utopie� – une dus-topia : une description du pays du malheur et du Mal, comme une utopie (eu-topia) est une description du pays du bonheur et du Bien ? Orwell a dit lui-même de son livre qu’il est « une utopie en forme de roman[12] ». On lit souvent 1984 comme si sa forme romanesque était accessoire, comme si l’intrigue du roman et son personnage central, Winston Smith, n’étaient que des moyens un peu artificiels et conventionnels utilisés par Orwell pour faciliter la description du fonctionnement de l’univers totalitaire qui serait son véritable objet. C’est ne pas prendre au sérieux Orwell comme écrivain et romancier. C’est négliger aussi la logique des genres littéraires : un roman n’est pas une utopie.
Une utopie de l’âge classique, telle qu’elle est canoniquement définie par l’Utopie de Thomas More ou par La nouvelle Atlantide de Bacon, par exemple, est l’imitation d’un récit de voyage. Nous y découvrons un monde lointain, quasiment inaccessible, un « pays de nulle part » (ou-topia), parallèle au nôtre, mais où les lois et les mœurs sont totalement différentes. Le narrateur par le truchement duquel nous effectuons ce voyage vient de notre monde ; il visite la société utopienne, observe les comportements de ses habitants, interroge des informateurs comme le fait un ethnographe, et revient ensuite parmi nous rapporter ce qu’il a vu et entendu. L’intrigue, dans la mesure où il y en a une, et les personnages sont entièrement subordonnés aux besoins de la description. Au sens de Kate Hamburger[13], l’utopie ne relève pas de la fiction strictement définie mais de la feintise, du comme si ; c’est un récit de voyage feint.
Le roman d’anticipation, au contraire, installe le plus souvent la société fictive qu’il décrit dans notre propre espace géographique, et la présente comme un avenir possible pour notre propre société. Le possible du roman d’anticipation n’est pas seulement un possible humain en général ; c’est un possible pour nous. Ceci est particulièrement vrai de 1984. L’action du roman se situe à Londres. Le régime politique qu’il décrit est censé s’être établi à l’issue d’une série de guerres nucléaires, de guerres civiles et de révolutions engendrées par la situation politique internationale d’après 1945.
Mais cela ne fait pas pour autant de ce roman une prédiction ou une prophétie. Dans un article de 1946 consacré à Burnham, Orwell écrit que « l’énorme empire esclavagiste, invincible et éternel dont Burnham semble rêver [rêve dont le monde de 1984 est la traduction romanesque] ne sera pas établi ou, s’il vient à l’être, [il] ne se maintiendra pas, car l’esclavage ne peut fournir une base stable à la société humaine[14] ». Dans une lettre du 16 juin 1949, Orwell est tout à fait explicite à ce sujet.
Je ne crois pas que le type de société que je décris doive nécessairement arriver, mais je crois (compte tenu, évidemment, du fait que ce livre est une satire) que quelque chose de semblable pourrait arriver[15].
Le héros lui-même, Winston Smith, est né en 1945, c’est-à-dire dans notre propre société. Son histoire est, au fond, celle d’un homme issu de notre société, d’un homme comme nous, qui, devenu par la force des choses et par les circonstances de l’histoire membre de la société nouvelle, ne parvient pas à s’habituer à ses normes et à ses mœurs et qui entre en révolte contre elle. Le roman tout entier est focalisé exclusivement sur lui. De la première à la dernière page, on ne le quitte jamais. Nous découvrons donc le monde de 1984 non par le truchement d’un visiteur étranger, mais à travers la vie de l’un de ses habitants qui refuse de s’y adapter.
Plus encore, nous le découvrons à travers ses yeux et ses pensées, car Orwell, dont on oublie trop souvent qu’il était un admirateur de Joyce, a utilisé dans son roman les techniques du roman psychologique moderne, notamment celles de la focalisation interne : on sait tout ce que sait, pense et sent le héros (le recours au monologue intérieur en style indirect libre est fréquent), mais on ne sait jamais rien de plus ni rien d’autre que ce qu’il sait. Même quand Winston a des idées qui se révéleront plus tard être des illusions, le narrateur n’adresse au lecteur aucun signe d’avertissement et ne manifeste jamais la moindre ironie à son égard. Au contraire, il y a pour employer le vocabulaire de Dorrit Cohn « convergence » entre la voix du narrateur et celle de son héros jusqu’à la fusion presque totale entre eux[16].
Dans le passage suivant, par exemple, Orwell mêle si bien ces deux voix que les pensées propres du héros deviennent des vérités générales certifiées par le narrateur, tandis que les informations factuelles que donne le narrateur sont colorées par la subjectivité du héros et semblent appartenir également à son monde intérieur.
Winston alla à la fenêtre, le dos au télécran. C’était une journée encore froide et claire. Quelque part au loin, une bombe explosa avec un grondement sourd qui se répercuta. Il y avait chaque semaine environ vingt ou trente de ces bombes qui tombaient sur Londres. Dans la rue, le vent faisait claquer de droite à gauche l’affiche déchirée et le mot Angsoc apparaissait et disparaissait tour à tour. Angsoc. Les principes sacrés de l’angsoc. Novlangue, double pensée, mutabilité du passé. Winston avait l’impression d’errer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inimaginable. Quelle certitude avait-il qu’une seule des créatures humaines pensait comme lui[17] ?
Le lecteur, ainsi placé à l’intérieur de la conscience du héros, ne voyant et ne connaissant du monde que ce que celui-ci en voit et en connaît, devient un habitant de 1984 : ce monde a pour lui la même opacité que pour Winston, et il suscite en lui les mêmes sentiments de solitude et de terreur. À la différence d’une utopie ou d’une contre-utopie, le roman nous fait vivre l’expérience d’habiter un tel monde, et il nous la fait vivre de l’intérieur.
2. L’expérience de lecteur du roman comme source de connaissance
En quoi l’expérience que nous vivons en lisant un tel roman peut-elle constituer une connaissance, ou servir à la constitution d’une connaissance ?
Pour essayer de répondre à cette question, je partirai d’un épisode important du roman où l’on voit à l’œuvre la double pensée, cette technique qui permet d’effacer volontairement de son esprit un souvenir ou une croyance, puis d’effacer aussitôt tout souvenir de cet acte d’effacement. Un des exemples les plus impressionnants en est donné par O’Brien, un des chefs de la police de la pensée, qui est à la fois intellectuel organique du Parti et bourreau. Il tient dans ses mains une photo qui constitue la preuve que certaines accusations portées par le Parti à l’encontre de trois de ses anciens dirigeants étaient mensongères ; il la montre à Winston, qui, quelques années auparavant, l’a lui aussi tenue entre ses mains, puis il la détruit en la jetant dans un « trou de mémoire », où elle est immédiatement dévorée par les flammes.
– Des cendres ! dit-il. Des cendres même pas identifiables. De la poussière. Elle n’existe pas. Elle n’a jamais existé.
– Mais elle a existé ! Et elle existe ! Elle existe dans la mémoire ! Je m’en souviens ! Vous vous en souvenez !
– Je ne m’en souviens pas, dit O’Brien.
Le cœur de Winston défaillit. C’était la double pensée. Il avait une mortelle sensation d’impuissance. S’il avait pu être certain qu’O’Brien mentait, cela aurait été sans importance. Mais il était parfaitement possible qu’O’Brien eut, réellement, oublié la photographie. Et s’il en était ainsi, il devait déjà avoir oublié qu’il avait nié s’en souvenir et oublié l’acte d’oublier. Comment être sûr que c’était de la simple supercherie ? Peut-être cette folle dislocation de l’esprit pouvait-elle réellement se produire. C’est par cette idée que Winston était vaincu[18].
Le lecteur peut, de prime abord, avoir le sentiment que cette scène est trop invraisemblable pour être réellement inquiétante et se dire que le comportement et le discours d’O’Brien sont par trop différents de ceux des êtres humains qu’il connaît. Mais ce passage peut aussi lui remettre en mémoire des circonstances où il a vu quelqu’un, peut être lui-même, oublier volontairement quelque chose qu’il savait être vrai et réussir à croire le contraire parce qu’il tenait à préserver à tout prix son adhésion à une certaine idéologie, ou son appartenance à un certain groupe. Il peut se rappeler, par exemple, l’espèce de « schizophrénie » qu’ont vécue pendant des années de nombreux dirigeants ou militants du Parti Communiste, en France, qui, d’un côté, n’ignoraient pas que le fameux rapport secret de Khrouchtchev au 20e Congrès du PCUS en 1956, tel que l’avait publié la presse dite « bourgeoise », était authentique, mais qui, de l’autre, avaient réussi à se convaincre fermement que c’était un faux. Quant aux quelques dirigeants qui avaient lu le rapport mais qui ont répété pendant des années qu’il n’existait pas, se pose à leur sujet la question de Winston à propos d’O’Brien : doit-on décrire leur comportement comme du cynisme ou comme relevant d’une forme de dissociation mentale ?
Ainsi, c’est l’expérience que le lecteur a de la vie réelle qui confère sa force et sa crédibilité à cette scène fictive, laquelle n’offre jamais que la variante la plus extrême d’un mécanisme intellectuel et psychologique largement répandu. Inversement, en nous présentant ce mécanisme dans sa perfection et sa pureté, débarrassé de tout frottement ou phénomène adjacent, le roman institue cette scène fictive en paradigme, c’est-à-dire en exemplaire à la fois singulier et typique à travers lequel identifier, comprendre et rapprocher les multiples cas de double pensée de la vie réelle, quels que soient le régime, l’idéologie et les circonstances historiques qui les ont engendrés. Quand il voit quelqu’un recouvrir des faits patents sous des considérations théoriques ou des subtilités dialectiques jusqu’à finir par les gommer ou les nier, ou quand il s’aperçoit qu’il est lui-même enclin à le faire, le lecteur peut y reconnaître la double pensée à l’œuvre, et s’efforcer à la lucidité et à l’honnêteté intellectuelle.
De la même manière, quand il entend une formule toute faite – un mot de la langue de bois, une expression journalistique – ou, mieux encore, quand elle lui vient sous la plume, le lecteur de 1984 peut y reconnaître du novlangue, c’est-à-dire à la fois identifier cette formule comme une idée préfabriquée, avoir clairement conscience qu’elle appauvrit la pensée, et s’efforcer d’utiliser des expressions plus justes et plus authentiques.
Parce qu’il situe son action dans une société fictive, le roman a la capacité de rendre perceptibles et comme physiquement sensibles au lecteur le système de connexions intimes qui existent entre les différents mécanismes totalitaires que sont le novlangue, la double pensée, la réécriture du passé, etc. Dans la réalité, ces divers mécanismes peuvent être rencontrés dans des circonstances très diverses, et le lien entre eux peut rester invisible. Le roman nous apprend à les voir comme les pièces ajustées d’une même machine.
C’est toujours parce qu’il attire notre attention sur ces phénomènes totalitaires dans une société fictive que 1984 nous apprend à les reconnaître partout où ils existent, dans n’importe quelle société totalitaire, et même dans une société non totalitaire. Il est très possible en effet que, dans la réalité, quelqu’un qui voit parfaitement le novlangue d’un régime se rende, pour des motifs quelconques, aveugle à celui d’un autre. Un exemple particulièrement impressionnant est celui de Victor Klemperer, l’auteur de LTI, la langue du 3ème Reich, dont la résistance intellectuelle et morale aux treize années de pouvoir nazi a été intraitable, dont les descriptions et les analyses sur la corruption de la langue allemande par le nazisme sont d’une lucidité et d’une pénétration incomparables, mais qui, après la guerre – pour des raisons qui sont, certes, biographiquement et culturellement assez compréhensibles – adhère rapidement au parti communiste de RDA, sans sembler (ou vouloir) voir que celui-ci diffuse et impose une autre novlangue, elle aussi corruptrice.
Bien sûr, depuis des siècles, philosophes, moralistes et écrivains n’ont pas attendu Orwell pour recommander la vigilance à l’égard du langage et de toutes les formes de mauvaise foi intellectuelle. Mais, parce qu’il met en lumière le rôle décisif que ces phénomènes jouent dans l’économie intellectuelle d’un système totalitaire, le roman rend cette vigilance plus urgente encore et, surtout, il nous apprend à y voir un enjeu et une responsabilité directement politiques. Les processus paradigmatiques que décrit le roman d’Orwell – novlangue ou double pensée – peuvent ainsi contribuer à la formation du jugement politique du lecteur exactement de la même manière que les personnages paradigmatiques que décrit le théâtre de Molière – Tartuffe, Alceste ou Harpagon – peuvent contribuer à former notre jugement moral.
Mais les épisodes comme celui de la photo qu’O’Brien réussit à oublier aussitôt qu’il l’a brûlée dispensent encore une autre sorte d’enseignement. Nous vivons tous avec la conviction, plus ou moins, qu’un pouvoir ne peut pas tout sur les individus et que, s’il peut briser les corps et contraindre les langues à chanter ses louanges, il ne peut pas pénétrer à l’intérieur des humains, qu’il ne peut ni forcer les esprits à croire à ses mensonges et ni contraindre leurs cœurs à l’aimer. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous convaincus que, nous non plus, nous ne pouvons rien sur nos propres croyances et que nous ne pouvons ni les décider ni les changer volontairement. Si je ne peux pas moi-même décider volontairement de croire ce que je ne crois pas, l’autorité politique ne peut pas non plus m’y contraindre. Elle n’a pas de pouvoir sur mes convictions parce que je n’en ai pas moi-même. Elle peut me forcer à l’hypocrisie ; mais elle n’a pas plus de moyen que je n’en ai moi-même d’agir sur mon « for intérieur ».
Comme l’écrit Locke dans sa Lettre sur la tolérance, « qu’un homme soit incapable de commander à son propre entendement […], c’est ce que démontrent à l’évidence l’expérience et la nature même de l’entendement, lequel ne saurait pas plus appréhender les choses autrement qu’elles ne lui apparaissent que l’œil n’est capable de voir dans l’arc-en-ciel d’autres couleurs que celles qu’il y voit, que celles-ci y soient réellement ou non[19] ». Mes croyances peuvent être vraies ou fausses parce qu’elles sont le produit de mon esprit, mais cette production est involontaire, comme celle des couleurs dans la perception : pas plus que je ne puis décider de voir d’autres couleurs que celles que je vois, je ne peux pas décider de croire autre chose que ce que je crois.
Dans le monde de 1984, ce postulat, qui est au fondement de la philosophie libérale, est démenti à chaque instant. Dans ce monde, on a prise sur son propre esprit. O’Brien peut décider volontairement d’oublier qu’il a vu ce qu’il vient de voir, et d’oublier cet oubli. Et quelques pages plus loin, il montre quatre doigts à Winston en lui ordonnant d’en voir cinq, et il le punit de ne pas y parvenir. En lisant 1984, je découvre que la barrière placée par le libéralisme entre le pouvoir politique et la conscience de chacun pourrait bien être illusoire : puisque chaque homme peut agir sur ses propres croyances ; et, puisqu’un pouvoir doté des moyens appropriés peut, par la souffrance infligée, par la peur ou par tout autre moyen, agir sur chacun, alors un pouvoir peut agir sur nos esprits et nous forcer non seulement à adopter les croyances de son choix mais à en changer à tout moment selon son gré.
Orwell n’en conclut évidemment pas que le libéralisme est condamné ou faux. Il en conclut que, si nous voulons le libéralisme, c’est-à-dire la préservation de ce qui est à la base de notre mode de vie depuis quatre siècles, cela dépend entièrement de nous, de notre volonté. Mais il n’y a pas dans la nature humaine, ou dans la raison humaine, de barrière infranchissable qui m’empêche de me faire croire ce que je veux, et donc pas de barrière infranchissable qui garde le pouvoir politique hors du for intérieur.
Tout l’enjeu du roman est là. 1984 raconte l’histoire d’un homme qui refuse d’adopter les stratégies intellectuelles et psychologiques qu’exige de lui le pouvoir totalitaire ; il sait qu’il n’aura jamais aucune liberté d’expression ni d’action ; mais il cherche à préserver sa liberté intérieure, c’est-à-dire la continuité de ses souvenirs, l’authenticité de ses sentiments et la capacité de former ses convictions à partir de son expérience et de sa raison. Dans les premières pages, Winston contemple une pièce de monnaie sur laquelle est gravé le visage de Big Brother : « Toujours ces yeux qui vous observaient et cette voix qui vous enveloppait. Dans le sommeil ou la veille, au travail ou à table, au-dedans ou au-dehors, au bain ou au lit, pas d’évasion. Rien ne vous appartenait sauf les quelques centimètres cubes de l’intérieur de votre crâne.[20] » À la fin du roman, le lecteur apprendra que même l’intérieur de son propre crâne n’appartient pas à Winston. Comme le lui dit O’Brien, « nous allons vous presser jusqu’à ce que vous soyez vide, puis nous vous remplirons de nous-mêmes[21] ». Et c’est ce qui arrive en effet.
Au cœur de l’affrontement entre Winston et O’Brien, il y a l’idée d’humanité, non pas au sens biologique mais au sens anthropologique, qui est indissociablement psychologique, intellectuel et moral, au sens où nous n’accepterions plus d’appeler « humaine » la vie dans un régime comme celui de 1984 s’il aboutissait à ses fins. « Jamais plus vous ne serez capable de sentiments humains ordinaires, dit O’Brien à Winston. Tout sera mort en vous. Vous ne serez plus jamais capable d’amour, de joie de vivre, de rire, de curiosité, de courage, d’intégrité. Vous serez creux.[22] »
Le roman nous apprend donc à quelles conditions l’humanité est possible. Il nous met en présence d’une société d’où la vérité objective a disparu, d’un monde où l’accès à la vérité est devenu impossible ; et il nous montre, expérimentalement pourrait-on dire, tout ce qui s’ensuit : dans un tel univers sans vérité, il n’y aurait plus non plus, par voie de conséquence, ni sentiments sincères, ni liberté, ni communauté. Il n’y aurait plus que des individus atomisés, emplis de croyances et de sentiments que leur insuffle le pouvoir et que celui-ci peut leur faire modifier à tout moment. C’est le sens de la maxime que Winston inscrit dans son journal : « La liberté, c’est de dire que deux et deux font quatre. Quand cela est accordé, le reste suit.[23] »
Le roman nous apprend ainsi à voir l’être humain comme un être périssable et destructible. C’est une idée qui nous est insupportable et nous nous rassurons en parlant de nature humaine ou de dignité imprescriptible. Mais la nature humaine peut facilement être broyée et la dignité détruite. Une des pages les plus terribles du roman est sans doute cette scène d’Ecce homo où O’Brien force Winston, abîmé par des semaines ou des mois de torture, à se regarder dans une glace. « Vous pourrissez, dit-il. Vous tombez en morceaux. Qu’est-ce que vous êtes ? Un sac de boue. Maintenant, tournez-vous et regardez-vous dans le miroir. Voyez-vous cette chose en face de vous ? C’est le dernier homme. Si vous êtes un être humain, ceci est l’humanité. Maintenant, rhabillez-vous.[24] » Quelques minutes plus tôt, il lui a expliqué : « Vous imaginez qu’il y a quelque chose qui s’appelle la nature humaine qui sera outragé par ce que nous faisons et se retournera contre nous. Mais nous créons la nature humaine. L’homme est infiniment malléable.[25] »
Ici, il faut toutefois prendre garde. 1984 n’est pas un roman à thèse. O’Brien a une thèse, celle de la malléabilité infinie des hommes, mais le roman n’en a pas. Certes, il refuse de se laisser enfermer dans le postulat rassurant de Locke : trop de phénomènes contemporains parlent contre. Mais il n’endosse pas pour autant la thèse de la malléabilité illimitée des sociétés humaines et des individus. Dans certains textes contemporains de la rédaction de 1984, Orwell suggère même, dans une veine tout à fait rationaliste, qu’une société qui aurait congédié l’idée de vérité objective ne survivrait pas plus d’une ou deux générations. Simplement, il constate que l’essor des techniques de surveillance, de propagande et de contrainte des corps nous oblige à nous passer de l’idée d’une nature humaine fixe et à nous demander jusqu’où les humains sont malléables.
En janvier 1939, il écrivait déjà :
Dans le passé, chaque tyrannie finissait tôt ou tard par être renversée, ou du moins par rencontrer des résistances, grâce à la “nature humaine”, immanquablement éprise de liberté. Mais nous n’avons absolument aucune certitude que la nature humaine soit invariable. Tout comme on peut créer une race de vaches sans cornes, peut-être est-il possible de créer une race d’hommes qui n’aspirent pas à la liberté. L’Inquisition a échoué, mais elle ne disposait pas à l’époque des ressources de l’État moderne. La radio, la censure de la presse, l’éducation uniformisée et la police secrète ont tout changé. Le conditionnement des masses est une science née dans les vingt dernières années et nous ignorons encore jusqu’où la porteront ses succès[26].
Que fait alors Orwell dans 1984 ? Un peu comme certains biologistes créent des chimères pour étudier les lois de la reproduction animale, il crée une société fictive monstrueuse où le pouvoir est absolu et la malléabilité humaine illimitée, afin d’explorer dans toutes leurs conséquences les processus totalitaires déjà à l’œuvre dans notre monde. Le roman fait de nous les habitants d’un monde qui pourrait à l’avenir être le nôtre pour qu’à partir de lui nous puissions regarder celui où nous vivons aujourd’hui.
Ainsi le roman nous ouvre-t-il la possibilité de voir notre propre monde depuis le monde cauchemardesque qui est son avenir possible. Pris nous-mêmes dans notre propre société et dans les formes de description progressistes qu’elle se donne d’elle-même, nous avons tendance à mesurer tous les événements politiques et historiques à l’aune de l’idée de progrès ; à décrire, par exemple, le nazisme avec les catégories des Lumières comme la rechute temporaire d’une société hautement évoluée dans une barbarie primitive et l’obscurantisme ; ou bien à décrire le communisme russe dans le langage de l’économie comme une période d’accumulation primitive du capital conduite par l’État dans un pays sans bourgeoisie. Dans ces descriptions, comme dans toutes celles qui relèvent d’une optique progressiste, le nazisme et le communisme ne sont ou n’auront été que des avatars, régressions ou digressions temporaires, dans la marche inéluctable du progrès. 1984 nous force à briser cette forme de description et à nous poser la question : et si le totalitarisme était l’avenir de l’humanité ? Et si le nazisme et le communisme soviétique étaient les précurseurs des sociétés du futur ? Et si l’avenir était à des systèmes où l’État est accaparé par une oligarchie asservissant l’immense majorité de la population grâce à une combinaison de technologies modernes de surveillance, de « mensonge organisé » et de terreur qui lui permettent le contrôle des esprits ?
Kundera aurait tout de même pu s’apercevoir qu’aujourd’hui des jeunes gens pour qui le communisme soviétique appartient à une histoire qu’ils n’ont même pas connue, continuent de lire 1984, et se demander comment ce livre peut bien avoir un quelconque intérêt pour eux s’il n’est, comme il le prétend, qu’une œuvre de propagande et, donc, une œuvre de circonstance. L’intelligence politique d’Orwell, au contraire, est d’avoir vu le nazisme et le communisme comme les premières manifestations d’un nouveau type d’organisation qui risque de demeurer pendant très longtemps un avenir possible dans lequel peuvent à tout moment basculer nos sociétés démocratiques. Son sens humain est d’avoir éprouvé ce cauchemar bien avant les autres et plus intensément. Son imagination et son talent de romancier est d’avoir su donner à ce cauchemar qui est toujours le nôtre la forme d’un roman.
Nous pouvons à partir de là commencer à répondre à notre question : Quel genre de connaissance nous donne 1984 ?
3. Quel genre de connaissance nous donne 1984 ?
1984 est la description d’un monde fictif qui nous fait voir sous une nouvelle perspective le monde réel. Il nous apprend à voir certaines transformations du langage ou certains processus psychologiques et intellectuels comme totalitaires et destructeurs de l’humanité en nous ; il nous apprend à voir l’humanité elle-même comme périssable et destructible. 1984 veut ainsi éduquer notre capacité de jugement moral et politique. N’en déplaise à Kundera, il s’agit bien d’une connaissance, mais elle ne saurait s’énoncer sous forme de propositions ; ce n’est pas un savoir propositionnel. C’est une capacité à voir la société, les hommes et soi-même sous une perspective nouvelle. Récit de fiction, le roman ne saurait construire une image du monde que nous puissions comparer avec lui. Un roman ne décrit pas, à proprement parler, le monde réel. Mais il construit son monde fictif comme une image à travers laquelle le monde réel peut être vu et mieux compris. Le roman est un appareil optique au moyen duquel le lecteur peut ensuite redécrire le monde où il vit.
1984 ne contient pas de propositions susceptibles d’être vraies ou fausses, qu’elles soient particulières comme dans un livre d’histoire ou un article de journal, ou générales comme dans un traité scientifique ou un livre de philosophie. Il ne contient même pas le genre de considérations psychologiques générales ou de sentences morales dont certains auteurs classiques comme Stendhal ou Thackeray ponctuent leur récit quand ils sortent pour quelques phrases du monde de la fiction et s’adressent directement à leur lecteur. Dans 1984, on l’a vu, il n’y a pas de voix off du narrateur qui commente l’action.
On y trouve bien des propositions générales, mais celles-ci sont toujours prononcées ou pensées par l’un ou l’autre des personnages. Elles ne sont donc pas séparables du contexte dans lequel elles sont proférées, ni de la personnalité de celui qui les profère. Elles font partie du monde de la fiction, à l’intérieur duquel elles peuvent trouver confirmation ou démenti. Le roman met ainsi à l’épreuve les affirmations générales de ses personnages. Mais décider du résultat de cette mise à l’épreuve est toujours, en dernier ressort, l’affaire du lecteur. Ainsi, il est clair pour tout lecteur que le roman confirme la maxime de Winston « la liberté est de pouvoir dire que “deux et deux font quatre” », et qu’il dément son affirmation initiale qu’aucun pouvoir ne peut pénétrer à l’intérieur de la tête d’un individu ni modifier ses sentiments. Mais c’est le lecteur instruit par le roman qui en juge ainsi. C’est lui qui, le livre une fois refermé, s’il accepte d’être changé par sa lecture et s’il choisit d’adopter sur le monde la perspective du roman, reprendra peut-être à son compte telle ou telle affirmation sur la liberté.
Le roman lui-même ne soutient donc ni thèse ni hypothèse ; il m’offre un élargissement et, éventuellement, une transformation de ma vision du monde. Il m’ouvre, par exemple, à la vision dérangeante d’un monde où les humains peuvent croire ce qu’ils savent être faux sans être pour autant des menteurs ou des cyniques. À partir de là, j’aurai à juger chaque fois si les O’Brien que je rencontre sont de vulgaires menteurs ou des virtuoses de la double pensée. Et, bien entendu, mon jugement pourra être vrai ou faux ; et il y aura des critères pour cela. Le roman, lui, m’offre simplement un réaménagement de mes concepts : outre les cas où quelqu’un est sincère et les cas où il ment, il y aura désormais pour moi les cas où il a recours à la double pensée.
Le genre de connaissance politique et morale que nous donne le roman diffère donc profondément de celle que pourrait nous donner une théorie politique. Ce n’est pas du tout une connaissance théorique.
Cela ne signifie pas qu’Orwell nie l’importance des théories et des débats d’idées en politique. Tout au long de sa carrière de journaliste et d’écrivain politique, Orwell n’a cessé de rendre compte d’ouvrages de réflexion politique comme ceux de Burnham, de Russell, de Borkenau, de Koestler et de beaucoup d’autres, et il collectionnait systématiquement toutes les brochures politiques qu’il pouvait trouver. Il a écrit lui-même des essais politiques comme Le lion et la licorne et il en a publié un certain nombre écrits par d’autres, comme la collection des Searchlight Books qu’il co-dirige en 1941-1942. À partir de 1941 également, il a collaboré très régulièrement à la grande revue intellectuelle de la gauche radicale américaine, Partisan Review, et maintenu des échanges nourris avec ce qu’on a appelé le « trotskisme littéraire » aux États-Unis[27]. Mais il est également vrai que lui-même n’a jamais été marxiste, ni attiré par le marxisme ; il ne s’est jamais intéressé à l’économie et il pensait que la collectivisation des moyens de production, si elle est une condition nécessaire du socialisme, peut aussi conduire au pire des esclavages comme le montre l’exemple de l’Union soviétique. Il s’est toujours défié des philosophies de l’histoire et de toutes les théories qui prétendent savoir où va l’humanité. Plus fondamentalement, pour lui, ce ne sont pas des théories qui peuvent fonder les options politiques fondamentales de chacun, mais sa propre expérience de la société et des hommes. Ce qui a fait d’Orwell le socialiste radical qu’il a été de 1936 à sa mort, c’est son expérience de l’oppression coloniale en Birmanie, celle de la vie quotidienne de la classe ouvrière du nord de l’Angleterre à l’époque de la grande crise, et celle de la fraternité révolutionnaire vécue avec les combattants antifascistes de la guerre d’Espagne.
(1) Le discours théorique est un discours sur, un discours de l’extérieur. C’est le discours de quelqu’un qui se place hors de ce monde pour le décrire, soit qu’il n’y habite pas, soit, s’il en est un habitant, qu’il essaie de faire comme s’il n’en était pas un, en s’extrayant autant que faire se peut de son monde et de tout monde. Le roman, lui, est un discours dans, un discours qui nous donne un point de vue de l’intérieur. Il nous fait habitants d’un monde fictif pour nous faire mieux comprendre la situation qui est la nôtre en tant qu’habitants du monde réel, et, dans le cas de 1984, en tant qu’habitants d’une société moderne où prolifèrent les germes totalitaires. À cet égard, le roman est un instrument d’éducation politique particulièrement approprié puisque, quand nous avons des jugements politiques à porter sur tel homme ou tel événement, notre situation est celle d’un habitant de ce monde, pas celle d’un théoricien.
Le roman offre ainsi au lecteur des paradigmes de choix et de conduites, mais ces exemples ne sont pas pour autant à suivre. Bien qu’il ait certaines qualités, Winston n’est certainement pas un héros positif comme il devrait l’être si 1984 était un roman de propagande. Ainsi lorsqu’il accepte d’entrer dans ce qu’il croit être une organisation oppositionnelle secrète appelée « La Fraternité », il se déclare prêt à devenir un terroriste et à commettre les forfaits les plus noirs comme jeter de l’acide sulfurique au visage d’un enfant. Tout le chapitre est la parodie d’une scène de conspiration avec serviteur muet et pacte diabolique (encore qu’à en juger par certaines formes contemporaines de terrorisme, on peut se demander si, bien qu’elle ne soit pas réaliste, cette scène n’en est pas moins vraie). Elle est manifestement destinée à montrer comment, dans un système totalitaire, les opposants les plus déterminés sont poussés à agir selon la même logique inhumaine que le système qu’ils prétendent combattre, et sont incapables d’imaginer une autre fraternité que celle de la terreur. Le roman cependant n’approuve ni ne condamne explicitement ce choix de Winston, mais, par la simplification outrancière qu’il opère, il fait comprendre la logique des actions dans un tel univers à un lecteur qu’il met en situation. Celui-ci n’est pas spectateur impartial, mais acteur potentiel.
(2) Un discours théorique est un discours qui s’efforce de tenir à l’écart toute émotion. La connaissance romanesque, au contraire, est une connaissance par les émotions. Prenons un exemple simple. Le lecteur croit, comme Winston, que lui et Julia, la jeune femme qu’il aime, ont trouvé un espace d’intimité et de secret dans une petite chambre que leur loue un vieil antiquaire et où ils sont persuadés d’échapper enfin à la surveillance de Big Brother. Soudain, la police fait irruption et le lecteur découvre alors, en même temps que les héros, que depuis le premier jour, toute leur vie dans cette chambre a été surveillée, filmée et enregistrée, et que le soi-disant vieil antiquaire était en réalité un jeune policier déguisé. Le sentiment qu’éprouve alors le lecteur est un sentiment d’oppression, le sentiment qu’un tel monde est un piège sans issue. Ce sentiment est évidemment celui qu’éprouvent les habitants d’une société totalitaire réelle, et c’est un élément constitutif de tout monde totalitaire. Un monde totalitaire ne consiste pas seulement en un système de propagande et d’appareils de pouvoir ; c’est aussi tout un ensemble de sentiments et d’émotions caractéristiques, spécifiques. Ce sentiment d’oppression et d’être pris au piège est même pour les habitants d’un tel monde totalitaire la forme de connaissance la plus juste qu’ils aient de ce monde : intellectuellement, ils ne le comprennent pas ou en sont les dupes ; émotionnellement, ils le ressentent comme une menace permanente pour leur intégrité personnelle, et ce sentiment est justifié. En faisant éprouver ce même sentiment au lecteur, le roman le fait accéder à une forme de compréhension authentique de l’univers totalitaire, et il produit ainsi bel et bien une connaissance.
Certes, un traité pourrait contenir la phrase : « Les habitants d’un monde totalitaire éprouvent un sentiment d’oppression : ils vivent ce monde comme un gigantesque piège. » Mais le lecteur d’un tel traité ne saurait pas plus ce que c’est qu’éprouver ce sentiment déterminé d’oppression qu’un aveugle ne sait ce que c’est que voir des couleurs. Seul le roman peut le décrire et le communiquer à quiconque n’habite pas un monde totalitaire. Il est inséparable des faits et gestes des habitants d’un tel monde et, en me décrivant les sentiments de personnages fictifs qui habitent un tel monde, le romancier me fait éprouver ce sentiment et me le fait donc connaître comme mon sentiment.
Il s’agit bien là d’une forme de connaissance, non pas à travers une idée mais à travers une émotion. En lisant 1984, j’acquiers une connaissance émotionnelle du totalitarisme qu’aucun traité de science politique ou de philosophie politique ne saurait m’apporter, et qui est essentielle pour la formation de mes propres jugements.
(3) Le discours théorique est un discours impersonnel d’où s’exclut celui qui l’énonce. Tout au contraire, la connaissance que nous apporte 1984 relève de la connaissance de soi. C’est une connaissance sur nous-mêmes, lecteurs du roman. Celui-ci nous dit à tous, et notamment aux intellectuels, et plus particulièrement encore aux intellectuels de gauche :
Apprenez à vous voir vous-mêmes comme des hommes qui préférez croire ce qu’une théorie ou des idées vous dictent plutôt que ce que vos yeux voient et ce que votre bon sens vous dit.
Apprenez qu’à nier comme vous le faites les vertus du sens commun, vous facilitez les dictateurs. Pire, vous vous faites vous-mêmes dictateurs des esprits.
Apprenez à vous voir comme des O’Brien en puissance. Vous avez la chance que vos débats d’idées n’aient la plupart du temps que des enjeux spéculatifs. Mais si vous aviez le pouvoir, tout le pouvoir, qu’en feriez-vous ? Qui seriez-vous ?
Et celui qui, dans le chaos des idées et de l’histoire, se cramponne à ce que ses yeux lui montrent et à son bon sens, celui que vous méprisez et traitez de naïf, d’humaniste, de petit bourgeois ou d’homme du sens commun, apprenez à le regarder comme le dernier rempart de l’humanité et de la civilisation, apprenez à le considérer comme le dernier homme.
Apprenez ainsi à voir les rapports entre les intellectuels de pouvoir et l’homme de la rue à travers l’affrontement entre O’Brien et Smith : l’intellectuel de pouvoir aura toujours le dernier mot, mais c’est l’homme de la rue qui a raison.
Cette question des rapports entre l’intellectuel et l’homme ordinaire hante depuis les années 1930 la pensée politique d’Orwell, mais aussi toute sa réflexion sur la littérature. Dans son grand essai sur Dickens, un de ses chefs d’œuvre, qui date de 1940, il écrit :
L’homme de la rue vit toujours dans l’univers psychologique de Dickens, mais la plupart des intellectuels, pour ne pas dire tous, se sont ralliés à une forme de totalitarisme ou à une autre. D’un point de vue marxiste ou fasciste, la quasi-totalité des valeurs défendues par Dickens peuvent être assimilées à la “morale bourgeoise” et honnies à ce titre. Mais pour ce qui est des conceptions morales, il n’y a rien de plus “bourgeois” que la classe ouvrière anglaise. Les gens ordinaires, dans les pays occidentaux, n’ont pas encore accepté l’univers mental du “réalisme” et de la politique de la Force[28].
À la différence des classes populaires, mais aussi des classes dirigeantes, les intellectuels anglais, de gauche comme de droite, ont cédé pour Orwell à la fascination pour la puissance. En septembre 1946, qui est le moment exact où il entreprend 1984, il écrit :
Les réalistes nous ont conduit au bord de l’abîme, et les intellectuels, chez qui l’acceptation de la politique de puissance a tué d’abord le sens moral puis le sens de la réalité, nous exhortent à aller de l’avant sans faiblir[29].
Et, à la lecture de l’essai intitulé James Burnham et l’ère des organisateurs, qui condense toute sa pensée politique à la même époque, on comprend que le monde cauchemardesque de 1984 représente, pour lui, ce à quoi ressemblerait en fait la réalisation des rêves de la plupart des intellectuels de gauche :
C’est seulement après que le régime soviétique est devenu manifestement totalitaire que les intellectuels anglais ont commencé à s’y intéresser en grand nombre. L’intelligentsia britannique russophile désavouerait Burnham, et pourtant il formule en réalité son vœu secret : la destruction de la vieille version égalitaire du socialisme et l’avènement d’une société hiérarchisée où l’intellectuel puisse enfin s’emparer du fouet[30].
Les intellectuels ne sont pas spontanément démocrates. Contrairement à l’image qu’ils ont souvent d’eux-mêmes, ils sont particulièrement vulnérables aux processus psychologiques et idéologiques totalitaires. Parce qu’ils sont des hommes de mots, d’idées et d’arguments, il leur est particulièrement facile de perdre le sens de la réalité et de renoncer au sens moral commun, à la common decency, à cette honnêteté commune que défendait Dickens.
Par exemple, dans un poème intitulé Spain, Auden exaltait la vie quotidienne des militants antifascistes en Espagne, le temps sacrifié en distributions de tracts et en meetings interminables, le risque qu’ils prennent de mourir au combat, bien sûr, mais aussi « L’acceptation consciente de la culpabilité dans le nécessaire assassinat (The conscious acceptance of guilt in the necessary murder). » Orwell commente ainsi ce vers :
L’expression « le nécessaire assassinat » ne peut avoir été employée que par quelqu’un pour qui l’assassinat est tout au plus un mot. En ce qui me concerne, je ne parlerais pas aussi légèrement de l’assassinat. Il se trouve que j’ai vu quantité de corps d’hommes assassinés — je ne dis pas tués au combat, mais bien assassinés. J’ai donc une idée de ce qu’est un assassinat — la terreur, la haine, les gémissements des parents, les autopsies, le sang, les odeurs. Pour moi, l’assassinat doit être évité. C’est aussi l’opinion des gens ordinaires. […] Le type d’amoralisme de M. Auden est celui des gens qui s’arrangent toujours pour ne pas être là quand on appuie sur la détente[31].
C’est aux intellectuels qu’Orwell adresse 1984, pour les mettre en garde contre eux-mêmes, mais aussi à l’homme de la rue, pour lui redonner confiance en lui-même et en son propre jugement contre les intellectuels de pouvoir.
Le Parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C’était son commandement ultime, et le plus essentiel. Le cœur de Winston défaillit quand il pensa à l’énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n’importe quel intellectuel du Parti le vaincrait dans une discussion, aux arguments qu’il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre Et cependant, c’était lui qui avait raison ! Ils avaient tort, et il avait raison. Il fallait défendre l’évident, le bêta et le vrai (the obvious, the silly and the true). Les truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l’eau est humide, et les objets qu’on lâche tombent vers le centre de la terre[32].
La question décisive en politique n’est pas de savoir si on dispose de la théorie vraie. Les théories politiques sont faillibles, partielles, et elles peuvent facilement devenir des instruments de pouvoir et de domination. La question décisive est de savoir comment, dans le monde moderne, chacun, même s’il est un intellectuel, peut rester un homme ordinaire, comment il peut conserver sa capacité de se fier à ses sens et à son jugement, comment il peut préserver son sens du réel et son sens moral.
Si, pour écrire son grand livre politique, Orwell choisit la forme du roman, c’est aussi parce que celui-ci, genre populaire et genre non-théorique, est particulièrement approprié pour faire valoir, contre toutes les dialectiques, la perspective de l’homme ordinaire.
(4) Le discours théorique s’adresse à l’entendement exclusivement ; le roman, lui, s’adresse à la volonté. Soit cet énoncé théorique que j’emprunte au livre d’Hanna Arendt, Les origines du totalitarisme : « Le sujet idéal du règne totalitaire n’est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais l’homme pour qui la distinction entre le fait et la fiction (c’est-à-dire la réalité de l’expérience) et la distinction entre le vrai et le faux (c’est-à-dire les normes de la pensée) n’existent plus. [33] » Cet énoncé, tout à fait identique aux conclusions qu’on peut tirer de 1984, exige de son lecteur qu’il le comprenne, mais il n’appelle de sa part aucune réaction morale. Elle pourrait d’ailleurs figurer aussi bien dans un « Manuel du parfait dictateur postmoderne ».
Mais quand il lit dans 1984 le grand discours dans lequel O’Brien proclame que le Parti, bien supérieur en cela aux communistes et aux nazis, « recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir[34] », le lecteur peut être partagé entre des impressions et des réactions multiples et contradictoires : admiration pour cette démonstration brillante et angoisse devant les perspectives qu’elle lui découvre, fascination pour cette logique implacable mariée à une force tout aussi implacable et répugnance devant ce cynisme brutal et satisfait, désir trouble de trouver une assurance définitive à l’abri de ce pouvoir parfait et sentiment que le seul parti honnête est celui de Winston qui écoute ce discours enchaîné à son lit de torture. En même temps qu’elle suscite l’extériorisation de ces sentiments contrastés, cette page force le lecteur à les ordonner et à choisir son camp : elle lui apprend, dans une situation fictive, à s’abstenir d’admirer la puissance et à prendre le parti du faible. Et c’est une éducation importante car, comme l’écrit Orwell, « s’abstenir d’admirer Hitler ou Staline ne devrait pas demander un énorme effort intellectuel. Mais il s’agit en partie d’un effort moral[35] »
Kundera a raison : Orwell n’est pas Kafka. Et il n’est pas Joyce non plus. Mais cela Orwell le savait parfaitement, et il n’a jamais cherché à écrire le même genre de romans qu’eux en beaucoup moins bien. Il n’a pas essayé de marcher sur la ligne de crête des grands écrivains qui ont fait évoluer le roman européen par leurs inventions techniques et par les domaines nouveaux qu’ils lui ont ouvert. Il a voulu faire autre chose, quelque chose que Kundera, avec beaucoup d’autres, juge impossible : un roman politique, un roman qui contribue en tant que roman à former le jugement et la volonté politiques de ses contemporains. À en juger par la prégnance des mots et des images que 1984 laisse dans l’esprit de ses millions de lecteurs et par les réflexions qu’il continue aujourd’hui de nourrir, il est difficile de croire qu’il n’a pas réussi.
Ce texte est celui d’un exposé présenté le 17 décembre 2003 au Collège de France, dans le cadre du séminaire de Jacques Bouveresse. Il a été publié dans Jean-Jacques, Chroniques orwelliennes, Paris, Collège de France, 2013. Les Éditions de la rue Dorion remercient Céline Vautrin et Jean-Jacques Rosat de leur avoir acordé la permission de le reproduire.
[1]Milan Kundera, Les testaments trahis, Gallimard Folio, 1993, p. 268-269.
[1]Orwell, « Pourquoi j’écris » (1946), EAL-1, p. 25.
[2]Milan Kundera, Les testaments trahis, Gallimard Folio, 1993, p. 268-269.
[3]C’est un trait qu’Orwell emprunte aux théories de Burnham, l’auteur de L’ère des managers.
[4]Orwell, 1984, p. 105-107.
[5]Victor Klemperer, LTI, la langue du 3ème Reich, carnets d’un philologue, Albin Michel, 1996.
[6]Orwell, Lettre à Roger Senhouse, 26 décembre 1948, EAL-4, p. 551.
[7]James Conant, « Freedom, Cruelty, and Truth », in Robert B. Brandom, Rorty and his Critics, Blackwell, 2000, p. 293. Traduction française à paraître : James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, Agone, 2012.
[8]Orwell, « Où meurt la littérature » (1946), EAL-4, p. 82, & Lettre à H.J. Willmett (18 mai 1944), EAL-3, p. 193.
[9]Conant, op. cit., p. 295.
[10]Orwell, Lettre à Francis Henson, 16 juin 1949, EAL-4, p. 601.
[11]Orwell, « Réflexions sur la guerre d’Espagne » (1942), EAL-2, p. 322-325.
[12]Orwell, Lettre à Julian Symons, 4 février 1949, EAL-4, p. 569.
[13]Kate Hamburger, Logique des genres littéraires, Le Seuil, 1986.
[14]Orwell, « James Burnham et l’ère des organisateurs » (1946), EAL-4, p. 221
[15]Orwell, Lettre à Francis Henson, 16 juin 1949, EAL-4, p.� 601.
[16]Dorrit Cohn, La transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, Le Seuil, 1981.
[17]Orwell, 1984, p. 43.
[18]Orwell, 1984, p. 350-351.
[19]John Locke, Traité sur la tolérance, GF-Flammarion, p. 107-108.
[20]Orwell, 1984, p. 44.
[21]Orwell, 1984, p. 362.
[22]Orwell, 1984, p. 362.
[23]Orwell, 1984, p. 118.
[24]Orwell, 1984, p. 383.
[25]Orwell, 1984, p. 379.
[26]Orwell, « Recension de Russia under Soviet Rule de N. de Basily », EAL-1, p. 477-478.
[27]Sur tous ces points, lire John Newsinger, La politique selon Orwell, Agone, 2006.
[28]Orwell, « Charles Dickens » (1939), EAL-1, p. 573-574.
[29]Orwell, « Le gradualisme catastrophiste » (1945), EAL-4, p. 27.
[30]Orwell, « James Burnham et l’ère des organisateurs » (1946), EAL-4, p. 219.
[31]Orwell, « Dans le ventre de la baleine » (1940), EAL-1, p. 643-644.
[32]Orwell, 1984, p. 119.
[33]Hanna Arendt, Le système totalitaire, Le Seuil, 1972, p. 224.
[34]Orwell, 1984, p. 371.
[35]Orwell, « James Burnham et l’ère des organisateurs » (1946), EAL-4, p. 221.
Rares sont les personnes qui n’ont jamais entendu parler de 1984, le célèbre roman d’anticipation de George Orwell dont on souligne cette année le 70e anniversaire de parution. Big Brother fait désormais partie de notre imaginaire collectif et l’expression novlangue est passée dans l’usage. Jusqu’ici, malgré les multiples réimpressions, la traduction française publiée par Gallimard continuait à poser des problèmes avec ses 42 phrases manquantes par rapport à l’original et d’importantes coquilles, comme le fait de dire que les prolétaires constituaient 15 % de la population d’Océanie… au lieu de 85 % ! Profitant de cet anniversaire et prenant de court les autres maisons d’édition – car en France les œuvres d’Orwell entreront dans le domaine public en 2020–, Gallimard décidait enfin, en 2018, de lancer une traduction renouvelée, cette fois sous la plume de Josée Kamoun. Si cette nouvelle mouture présente un certain style, on se demande bien ce qui a motivé la traductrice à remplacer la locution police de la pensée par mentopolice et, surtout, de traduire littéralement newspeak par néoparler plutôt que de conserver le terme novlangue pratiquement devenu un concept de référence. Ce faisant, elle affadit la réflexion philosophique sur les liens entre langue et pensée, qui est pourtant au cœur de 1984.
Fort heureusement, une maison d’édition québécoise, les Éditions de la rue Dorion, nous propose une autre traduction qui restitue à ce livre culte sa vigueur philosophique. L’ajout de deux mises au point d’Orwell, dans lesquelles il précise ses intentions, permet d’ancrer la pensée de l’auteur dans son parcours de militant de gauche et donc d’en faire une lecture politique plus éclairée. En plus, la postface de la traductrice Celia Izoard vient renforcer et actualiser la réflexion sur le totalitarisme qui, trop souvent, a été cantonnée à la dénonciation du totalitarisme soviétique. Cette contextualisation est fort salutaire car, depuis quelques années, plusieurs auteurs associés à la droite conservatrice se réclament d’Orwell tant en Europe qu’au Québec. Ainsi, le 11 juin dernier, dans le Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, se basant sur Orwell, critiquait « la tentation totalitaire de la gauche universitaire médiatique ». C’est passer à côté du fait que la critique orwellienne du langage ne peut être ainsi réduite à une critique de la rectitude politique.
Plus que d’euphémisation du langage, c’est de sa distorsion dont il est radicalement question dans 1984, comme en témoignent les slogans légendaires du parti écrits sur la façade blanche du ministère de la Vérité: la guerre c’est la paix; la liberté c’est l’esclavage; l’ignorance, c’est la force. D’ailleurs, le concept même de liberté est appelé à disparaître puisque la novlangue est la seule langue qui évolue en s’appauvrissant : « Ne vois-tu pas que tout l’objet de la novlangue est de restreindre le champ de la pensée ? » rappelle Syme à Winston (p. 93). Et quand, dans ce roman, il est question de la doublepensée, on ne peut s’empêcher de penser à Donald Trump qui invente et impose des événements comme s’ils étaient réels (les fameux « faits alternatifs »). À la longue, un tel dévoiement du langage conduit à la déshumanisation et à l’impossibilité du politique, qui sont les ressorts ultimes du totalitarisme comme l’a bien montré la philosophe Hannah Arendt.
Assurément, cette nouvelle traduction peut venir tonifier la lecture de ceux et de celles qui connaissaient déjà 1984 et elle aidera de nouvelles générations friandes du numérique à mieux comprendre le monde – orwellien – dans lequel elles vivent.
Anne-Marie Claret
Relations, no 804, septembre-octobre 2019, p. 48.
VIVRE 1984 EN 2019 ?
George Orwell, supporter anglais d’une milice anarcho-marxiste, le POUM, en pleine guerre civile espagnole, en 1937, a vu l’avènement d’un monde troublant, à Barcelone, où le parti communiste fait la pluie et le beau temps.
« J’ai lu des articles de journaux qui n’avaient aucun rapport avec les faits, pas même le genre de rapport qu’implique habituellement le fait de mentir à leur sujet (…) Ce genre de chose m’effraie, car cela me donne le sentiment que la notion même de vérité objective est en train de disparaître de notre siècle ». Il va écrire, près de dix ans plus tard, un avertissement sous la forme d’un roman d’anticipation, 1984, une mise en garde nous avisons que idées totalitaires peuvent prendre racines « dans les esprits des intellectuels », et que si nous les combattons pas, un Big Brother, ou autre, va triompher partout.
Il faut encore lire 1984 pour ne pas le vivre en 2019, et on peut maintenant le faire dans une édition québécoise, grâce à une toute nouvelle traduction de Celia Izoard.
Pourquoi une autre ? L’an dernier, en France, avant que l’œuvre n’entre dans le domaine public, les éditions Gallimard avaient commandées, eux-aussi, une nouvelle traduction de Nineteen Eighty-Four d’Orwell à la professionnelle Josée Kamoun. Bonne idée ! Le travail d’Amélie Audiberti, de la première édition parue en 1950, comportait de nombreux défauts : des phrases manquantes, des fautes de détail, des contresens nuisant à l’intelligence de l’œuvre. Sauf que Josée Kamoun, « afin de rendre justice au texte d’un point de vue littéraire », va choisir de traduire au présent un récit écrit au passé par Orwell. De plus, « par souci d’exactitude » (!), elle va préférer substituer « néoparler » à la traduction « novlangue » usuelle, en français, depuis les années 1950.
Des choix qui ne peuvent satisfaire plusieurs admirateurs francophones de l’œuvre. Des choix qui vont mener à ce 1984 des éditions, québécoises, de la rue Dorion, avec cette traduction de Celia Izoard qui restitue la « temporalité d’origine » et la « facture classique » du récit d’Orwell, en restaurant «la dimension philosophique et la fulgurance politique dans les termes que des millions de lectrices et de lecteurs francophones se sont appropriés depuis plus d’un demi-siècle ». Bref, « en restant fidèle au projet qu’Orwell définit en 1946 : «Ce que j’ai voulu plus que tout, c’est faire de l’écriture politique un art » ».
Vivons nous 1984 en 2019 ? C’est le questionnement de Celia Izoard dans une postface de cette édition : « 1984 à l’heure de l’emprise numérique ».
En fait, notre monde n’est pas orwellien (le capitalisme « tient bon », et il n’a pas « d’ambiance de rationnement »), tout en l’étant avec cette « utopie de la communication qui s’est bel et bien matérialisée » sous sa forme la plus néfaste : des géants mondiaux qui administrent la vie personnelle de milliards d’individus, et la plupart des informations accessibles. « La numérisation des activités humaines a moins rapproché les individus les uns des autres qu’elle n’a rapproché les individus des machines ».
Le Winston Smith de 2019 ne vit pas « cadenassé dans sa solitude » sous le regard constant d’un Big Brother, mais épié et « conseillé » par le Big Data. Comme dans le roman d’Orwell, nous voilà obligé de mener une gymnastique de l’esprit, à faire « coexister » dans notre tête deux « propositions antagonistes » : notre environnement est entièrement conçu pour sonder nos allées et venues, nos goûts, notre intimité, « en vue de soutirer le plus d’argent possible », mais «à part ça », nous sommes libres. Posons-nous toujours la question : sommes-nous certains que nos pensées nous appartiennent entièrement ?
Nous pouvons y parvenir en permettant à l’esprit critique de subsister. Nous pouvons résister à l’envahissement du Big Data, par la solidarité, par la pratique d’activité, comme le suggère Celia Izoard, non subordonnées aux lois du marché, ou, tout simplement, en soumettant constamment nos pensées mercantiles à l’épreuve du « en ai-je vraiment besoin ? »
George Orwell a énoncé, avant son décès, dans une mise au point à son œuvre : « Je ne crois pas que le type de société que je décris arrivera nécessairement, mais je crois que quelque chose qui y ressemble pourrait arriver ». Ne permettons pas que 1984 se réalise, là est la morale de son cri d’alarme, « cela dépend de nous ».
– 1984. George Orwell (nouvelle traduction de Celia Izoard), Éditions de la rue Dorion.
Dans les romans qui nous projettent dans l’avenir, qu’ils soient de Wells ou de Huxley, de Bradbury, Döblin, Werfel ou même dans une certaine mesure dans l‘Héliopolis de Jünger, l’anticipation est rarement joyeuse ! La palme revient sans doute à La route de Cormac McCarthy, qui suit l’errance des rares survivants d’une catastrophe.
Contrairement à la science-fiction, qui recoupe ou inclut souvent l’utopie politique, dans 1984 pas de fusées intergalactiques, ni de robots plus intelligents que les hommes. George Orwell s’attache exclusivement à l’organisation politique et sociale d’un État imaginaire et reconnaissable avec des populations bien terrestres et pas de progrès technologiques notoires. Mais, il faut bien le dire, 1984 est sinistre et sa noire opacité s’accentue à mesure que le roman va vers sa fin, qu’on connaît d’avance et redoute, car elle est inéluctable.
Fiction ? Si l’on veut mais Orwell, homme de terrain, sait de quoi il parle. On a fait le compte de ses emprunts à la réa- lité qu’il a vécue : la politique de l’Empire britannique – dont il fut fonctionnaire en Asie -, la guerre civile espagnole – à laquelle il participa au sein du parti anarchiste éliminé par les communistes –, la misère extrême des quartiers populaires de Londres – sur laquelle il enquêta et écrivit –, la guerre froide entre les blocs de l’Est sous la gouverne soviétique et l’Ouest dominé par les États-Unis. C’est donc dans cette ambiance qu’il écrivit son roman en 1948. Pour compléter sa documentation, il avait sans doute en mémoire les procès de Moscou de 1937 et la grande paranoïa de Staline. Big Brother en a le visage et l’omniprésence sur les écrans, mais existe-t-il ? « Personne n’a jamais vu BB […]. C’est la figure sous laquelle le parti choisit de se présenter au monde.»
Le monde orwellien se divise en trois ensembles qui se livrent une guerre permanente: la guerre est une nécessité pour assurer la puissance d’un État toujours uni contre un ennemi, celui-ci changeant selon les circonstances. Ses méthodes ont fait leurs preuves : mobilisation perpétuelle, lavage de cerveau systématique pour entretenir la haine, révision de l’Histoire devant être mise à jour par une retouche continue des livres et journaux rapportant des événements antérieurs, surveillance permanente de tous et en tout lieu par des écrans partout répandus, délation encouragée à l’intérieur des familles, élimination (« vaporisation » des déviants).
Le protagoniste Winston Smith est l’un d’eux en pensée et il lui faut dans son consciencieux travail de « correction » de l’information être à chaque seconde sur ses gardes. La vie sexuelle est réprimée mais il enfreint l’interdiction de nouer une relation avec sa collègue Julia. Ils cachent leurs amours chez un vieil antiquaire qui leur inspire confiance. Un jour la foudre frappe: ils sont tombés dans le piège, arrêtés, séparés, emprisonnés. Dans ce régime implacable nul refuge possible, même dans la conscience personnelle comme Winston l’avait cru. Malgré ses résolutions il trahira aussi Julia. Le régime sait diaboliquement détecter les dissidents qui se rendent coupables du crime de « double pensée ». Winston est donc méthodiquement torturé pour sa « réhabilitation ». Le régime aura gagné, car, comme le lecteur s’en doutait, Winston, vidé de lui-même, finira par admettre que «deux et deux font cinq». Le roman conclut: « Il aimait Big Brother ».
Point n’est besoin de nous demander si les prévisions d’Orwell sont justes. Elles sont déjà réalisées ou en passe de l’être. Ainsi ce roman donne souvent l’impression bizarre de déjà-vu. Reviennent en mémoire les témoignages des rescapés de l’hitlérisme et du stalinisme (par exemple dans l’admirable livre de Svetlana Alexievitch – Prix Nobel – La fin de l’homme rouge, qui rassemble des récits de vie sur l’époque de Staline et celle qui l’a suivie). La réalité est à la hauteur de la fiction…
Non seulement le régime totalitaire impose systématiquement l’orthodoxie de la pensée unique mais grâce au langage simplifié et appauvri de la « novlangue », il annule tout souvenir de culture et le passé lui-même (le ministère de la Vérité y veille). D’ailleurs y eut-il un passé puisque tout est falsifié? Winston et Julia interdits de mémoire et de pensée comme tous leurs contemporains se demandent ce qu’il y eut avant la Révolution. Rien, tout a commencé avec elle. Pour bien modeler les esprits sont prévus des exercices quotidiens de haine dirigée sur des cibles désignées et renouvelables. Tout autre sentiment étant éliminé, il ne reste qu’un monde de terreur. Cependant Winston parvient à lire en secret le « livre de Goldstein », qui rétablit la réalité. Il constitue un véritable traité de dystopie et dans la trame romanesque un corps étranger (de lecture fort ennuyeuse…), comme si l’auteur avait voulu théoriser ce qu’il a mis en scène concrètement et habilement.
Un espoir peut-il subsister? Il viendrait de cette couche de la population tenue en marge et en laisse, les « proles » jugés ! trop inférieurs et parqués dans leurs quartiers sordides. Hurler avec les loups et garder son quant-à-soi ? Avec la conviction qu’énonce Julia : « Ils peuvent nous faire dire n’importe quoi, n’importe quoi mais ils ne peuvent pas nous obliger à y croire. Ils ne peuvent pas entrer en nous ». Acte de foi d‘Orwell ? On peut l’admettre mais il est bien fragile…
Ce récit où la part de fiction est mince par rapport à ce qu’aujourd’hui nous savons, nous fait évidemment réfléchir, car notre présent n’est en ses traits fondamentaux pas très différent de celui de l’auteur. En prolongeant et en durcissant les tendances qui pouvaient s’observer dans le monde après la Deuxième Guerre, Orwell fabrique un avenir, celui de 1984: le procédé est simple et l’intention évidente. Mais nous avons maintenant dépassé l’année 1984 et notre angoisse ne fait qu’augmenter.
On peut se demander : pourquoi l’actuel regain d’intérêt pour ce « classique » de la littérature d’anticipation? Pourquoi d’abord en faire une nouvelle traduction ? Celia Izoard explique que les précédentes étaient fautives, incomplètes et discutables. A coup sûr le succès est largement dû à la peur des événements qu’aujourd’hui nous voyons se profiler mais à la différence de ce qui est narré dans 1984, les causes actuelles de notre peur ne relèvent pas seulement d’un système politique mondial. Ce qui est envisagé est la fin de notre civilisation d’ici une ou deux décennies, voire la perspective – qui n’est pas un fantasme – que l’humanité disparaisse. Par dizaines, anthropologues, philosophes, économistes, financiers, démographes, politologues et climatologues font des projections qui convergent vers une rupture et un effondrement global de la société dans une planète devenue, peu à peu mais en accéléré, inhabitable. Ce serait (ils disent pour la plupart : se sera) un monde où les ressources énergétiques et alimentaires s’épuisent, par l’effet des dérèglements climatiques – désertification, pollution de l’eau et de l’air, disparition de la biodiversité biologique -, surpopulation (par exemple en Afrique) entraînant des vagues migratoires incontrôlables vers les pays d’Europe, accroissement par les ravages de l’économie de marché de l’écart entre riches et pauvres, donc source de guerres ouvertes avec la perspective jamais éliminée de conflits nucléaires. Les analystes sont quasi unanimes dans leurs conclusions mais collectivement, les gouvernements avec la plupart d’entre nous sont sourds et volontairement aveugles : ce monde de demain possible deviendra réalité si nous ne changeons pas notre mode de produire, de consommer, de vivre et de penser. Orwell pourrait aujourd’hui réécrire son livre sur des bases qui débordent le totalitarisme politique brutal et implacable de Big Brother et où celui-ci aurait un autre visage, mais nous avons de bonnes raisons de considérer l’auteur de 1984 comme un lanceur d’alerte.
Roland Bourneuf
Nuit blanche. Magazine littéraire, no 157, hiver 2020