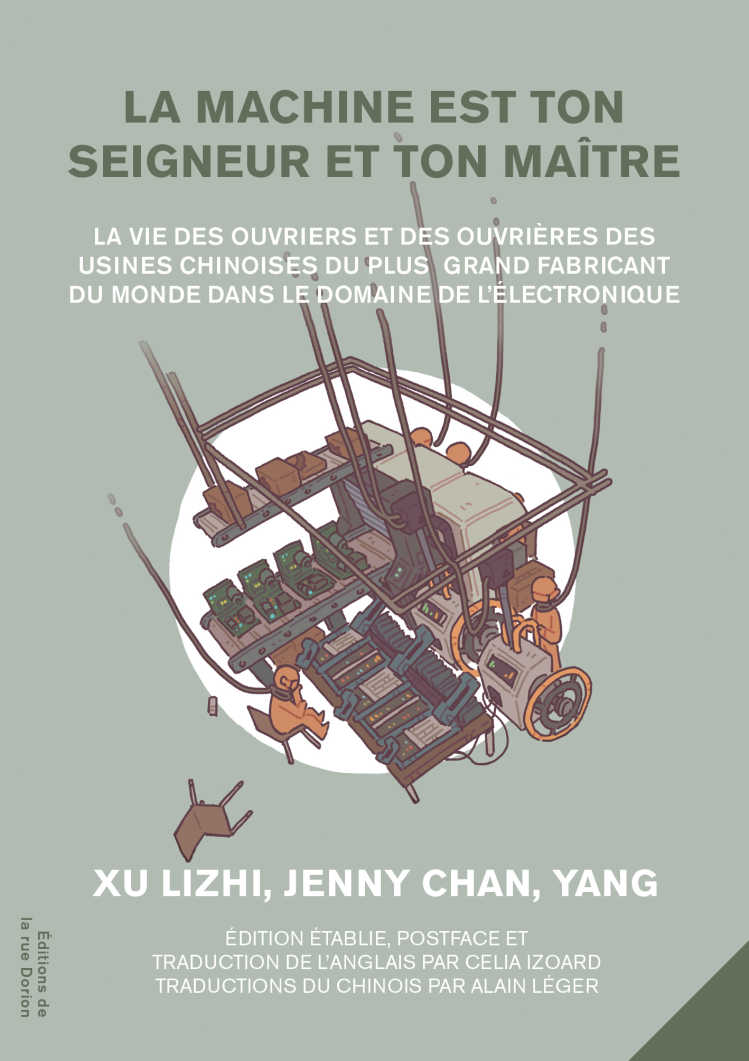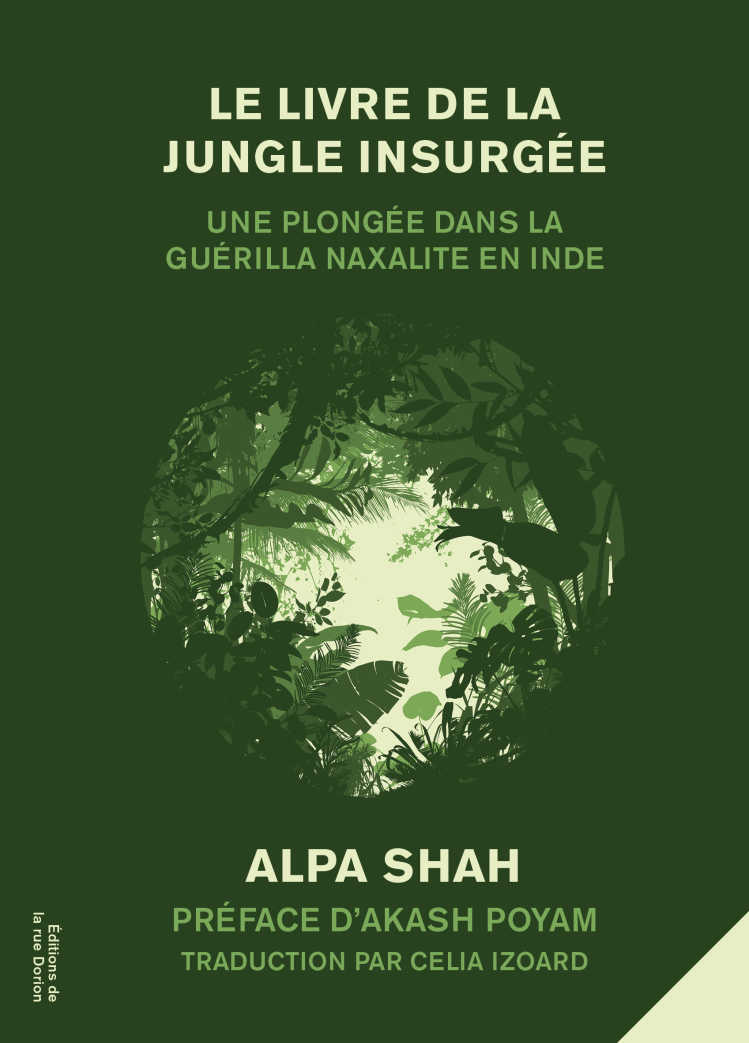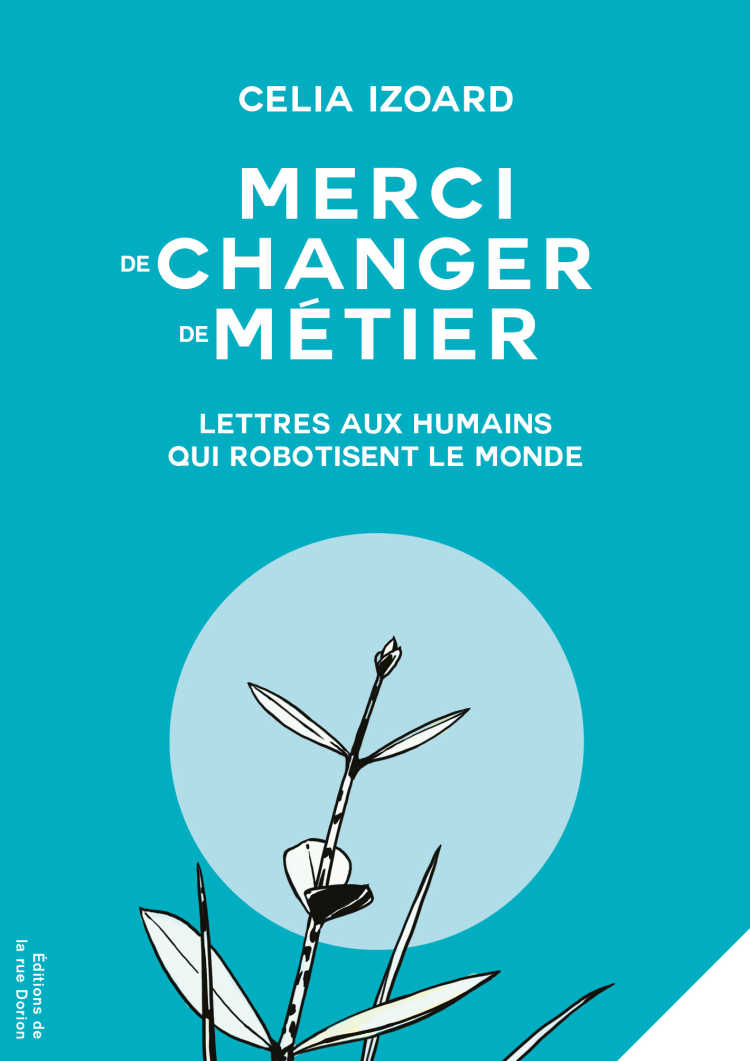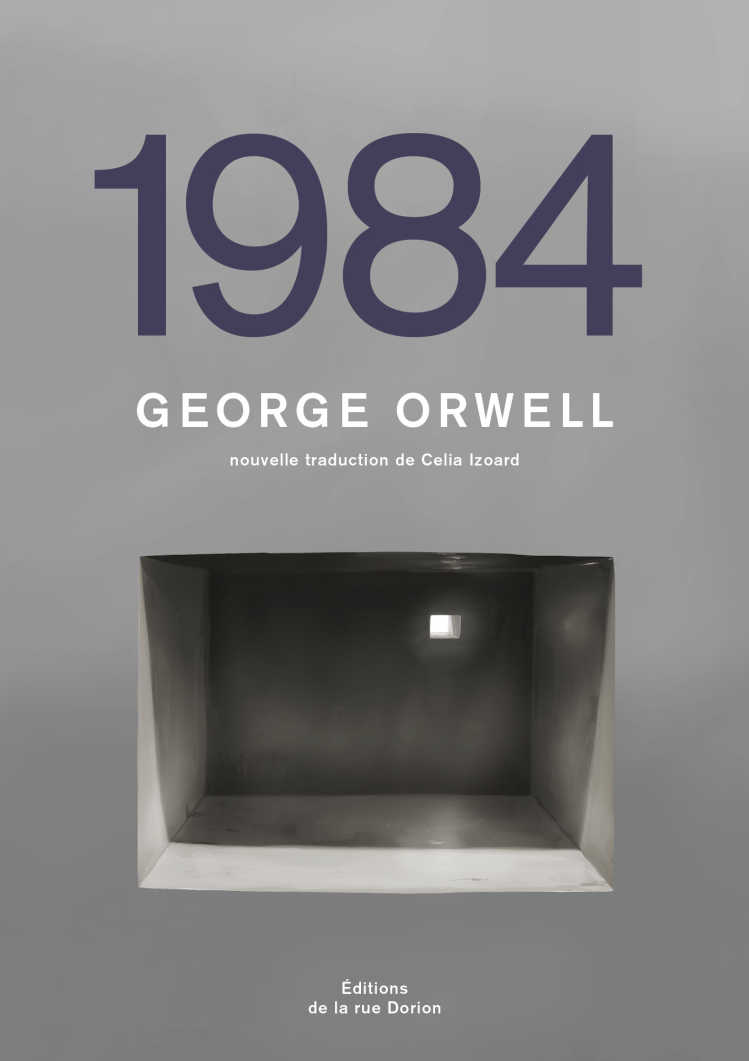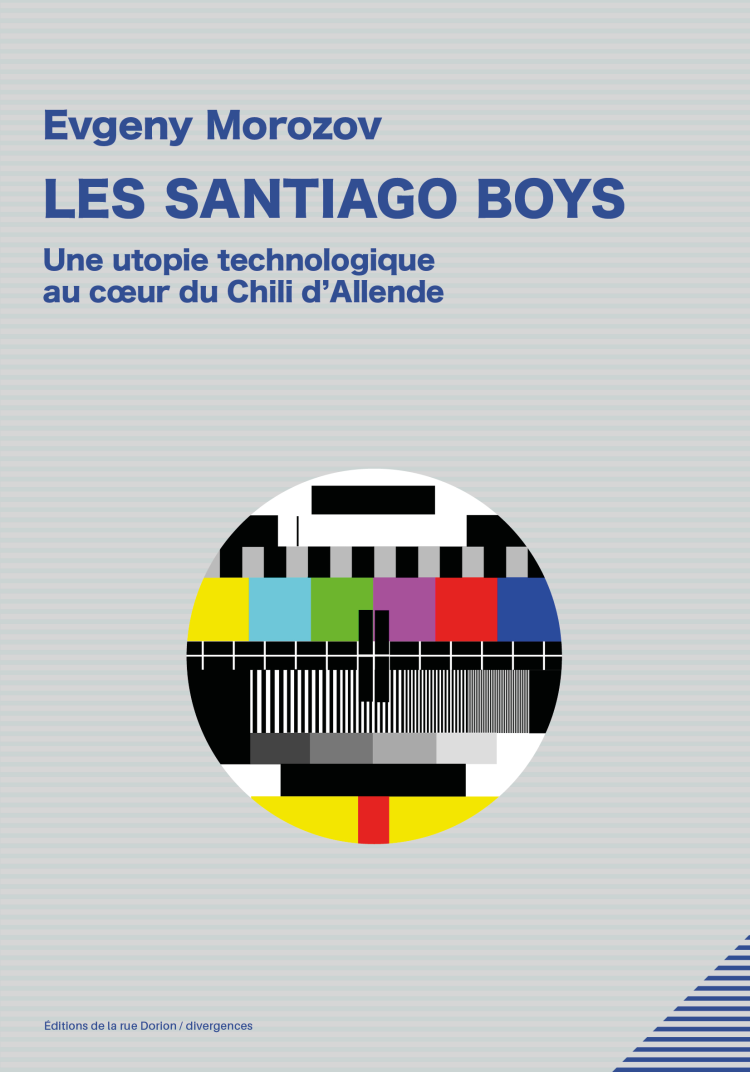Dans La ruée minière au XXIe siècle, la journaliste Celia Izoard affirme que la transition énergétique est une vaste opération d’écoblanchiment, beaucoup plus profitable aux grandes corporations qu’à l’habitabilité de notre planète.
Pour Izoard, également philosophe et essayiste (Merci de changer de métier, La révolte luddite), le passage idéalisé de l’énergie fossile à l’énergie renouvelable s’avère un marché de dupes aux dangerosités cachées et aux profits mal partagés« Continuer à faire croire […] qu’il est possible de supprimer les émissions de carbone en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel », écrit l’autrice, prônant la décroissance. « On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu’en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé se refusent de faire. »
Les matières nécessaires
La conclusion d’Izoard repose sur le fait qu’il faudrait multiplier jusqu’à un niveau inédit dans l’histoire de l’homme la production et la transformation de minéraux afin d’espérer électrifier ne serait-ce que le parc automobile planétaire. Une augmentation vertigineuse de la production qui se jumèle avec la croissance fulgurante du nombre de minéraux exploités. Un téléphone contient 50 métaux différents, rappelle la journaliste.Mais la transition n’est jamais qu’une figure rhétorique. Dans la pratique, elle cède le pas aux nombreux champs de la numérisation, à l’aérospatiale, aux télécommunications, etc.Si le cuivre est utile à la transition, il est majoritairement utilisé pour le secteur du bâtiment et du numérique. Quelles quantités de métaux seront nécessaires à l’augmentation attendue du nombre de centres de données? Et pour la 5G? Un expert en économie circulaire cité dans l’ouvrage estime que celle-ci nécessitera des quantités monstrueuses sinon prohibitives de palladium, de ruthénium, de terbium, de béryllium et de graphite.
Écologique ou numérique
« La croissance du numérique a en quelque sorte été embarquée discrètement comme un passager clandestin de la transition », résume Celia Izoard.Il est vrai que le terme « minéraux critiques », selon certaines définitions, désigne autant les matières premières nécessaires à la « nouvelle énergie » qu’à « notre avenir technologique ». Et que les minéraux critiques sont difficilement dissociables des minéraux stratégiques, définis comme constituant « un enjeu économique et politique majeur », une autre dynamique analysée par l’autrice de La ruée minière.Quoi qu’il en soit, pour elle, transition écologique et croissance numérique sont incompatibles.
Les mines 4.0
Celia Izoard analyse aussi l’évolution de l’industrie minière. La fameuse mine 4,0 où le pétrole fait bon ménage a surtout évolué dans sa productivité et son gigantisme, très peu dans son approche dans la sauvegarde de l’environnement, avance-t-elle. « La mine 4,0 cumule la voracité en ressources de l’extraction et celle de l’informatique », résume Izoard.La ruée minière a le potentiel d’accentuer le chaos climatique, de rendre la planète plus invivable par la pollution des eaux, la destruction de la biodiversité et des conditions de subsistance des populations, l’accumulation de déchets toxiques.Discours catastrophiste, éloigné de la réalité? À voir. De prime abord, l’œuvre apparait solide et bien documentée. Dans la lignée de La guerre des métaux rares, de Guillaume Pitron, c’est un livre troublant qui vaut la peine d’être réfuté, sinon d’ouvrir un dialogue.