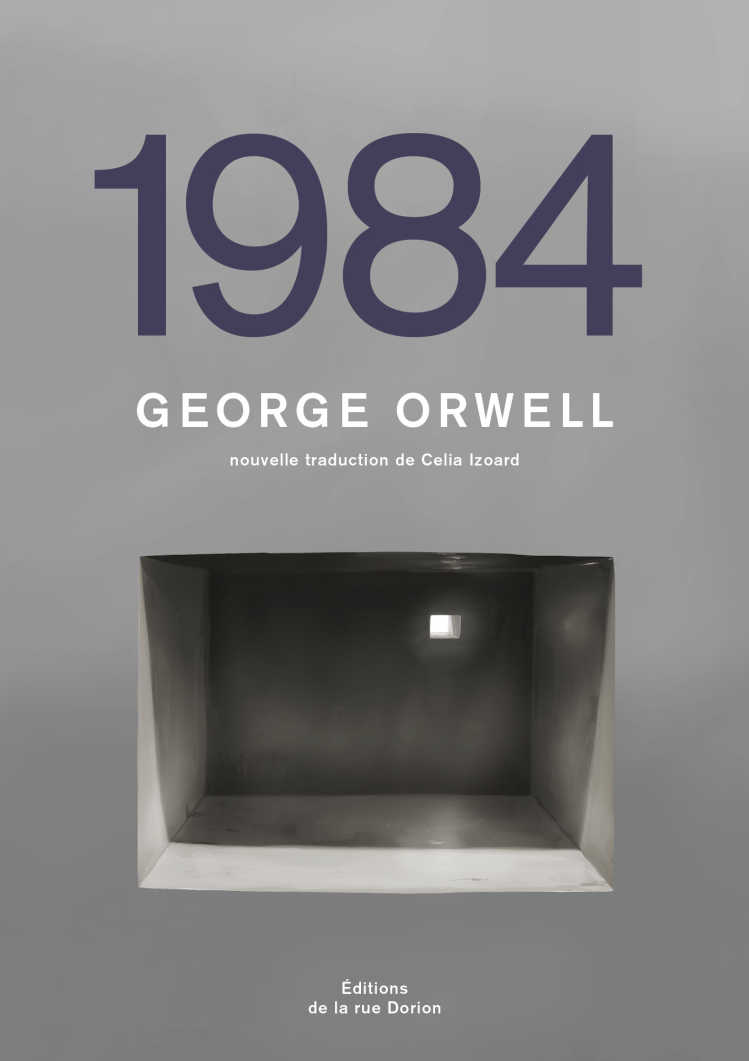Le petit livre de Celia Izoard, composé de plusieurs textes sous forme notamment, de lettre à des ingénieurs, brille par sa simplicité. D’une plume faussement naïve, la journaliste questionne ceux qui façonnent les outils « du futur » – robots, logiciels – à propos de leur responsabilité vis-à-vis du reste de le société. Sans moralisme, ni accusations mal placées, elle les appelle à se réveiller.
Le premier texte d’Izoard, et aussi le plus long, s’adresse aux ingénieurs qui travaillent sur le véhicule autonome, qu’il soit utilisé à titre individuel ou collectif. Voilà déjà plusieurs années que cet avenir de la mobilité – un parmi d’autres – est au centre de nombreux et passionnants questionnements. Cependant, la voiture autonome ne fait fondamentalement pas débat, pas au sens politique en tout cas « car la technologie n’est pas censée être politique », ironise l’autrice. Sa démarche – s’adresser à des ingénieurs – a cela d’utile et d’original qu’elle vise à toucher ceux qui sont au cœur de réacteur, sans doute à défaut de pouvoir toucher le système économique et ses logiques dans son ensemble.
« Aujourd’hui, vous mettez tout ce qui fait de vous des gens vivants et en mouvement au service de ce projet-là (…) C’est vous qui faites le boulot, et qui pourriez choisir de ne pas le faire. » Izoard, maligne, ne se contente pas de susciter le doute, mais bien de l’alimenter, chemin faisant, de ses propres inquiétudes concernant de tels véhicules.
Inquiétudes sociales d’abord : à quoi sert vraiment le véhicule autonome – au-delà des vertus qu’on lui prête sans preuves – sinon à réduire le coût de la force de travail ? Est-ce pour limiter le nombre d’accidents par exemple, qu’Uber dépense 20 millions de dollars par mois dans son développement ? « Si c’est ça le progrès, alors le progrès est manifestement le nom qu’on donne au bon vouloir des milliardaires de la Silicon Valley, que les technocrates de tous les pays semblent retranscrire fiévreusement en politiques nationales dans la minute, de peur de rater une marche sur l’escalier de la croissance »
En Europe, des centaines de millions d’euros d’argent public font les choux gras d’une industrie automobile en quête de débouchés économiques. Peu s’interrogent cependant sur les effets directs qu’auraient ces projets sur l’urbanisme, la standardisation des routes, des villes, le déploiement de capteurs par millions afin de rendre ces environnements lisibles et explicites pour des robots… Sans parler de la quantité de données récupérées au passage. Pourquoi une telle priorité dans les investissements ? « Pourquoi la première urgence serait-elle de faire rouler des véhicules sans conducteur ? »
En effet, les vertus écologiques ou en terme de décarbonation de la mobilité ont de quoi faire douter. Izoard demande : « comment le principe même de remplacer un conducteur ou une conductrice, qui n’a besoin pour conduire que de son propre corps, par des milliers de capteurs, caméras, lidars, batteries, processeurs, data centers pourrait être une réponse écologique. » La voiture autonome risque en effet de susciter un certain nombre d’effets rebond. Non seulement l’électronique embarqué n’est pas neutre, ni du point de vue des ressources, ni de celui de la durée du véhicule, mais le nombre de trajets risque d’augmenter avec la facilité d’accéder à des véhicules à la demande. Ainsi, une équipe de l’université de Berkeley a offert à plusieurs familles le service d’une voiture avec chauffeur soixante heures par semaine. « Cela permettait de simuler le confort apporté par un véhicule autonome, capable de se conduire et d’aller se garer tout seul. Résultat : les distances parcourues par ces familles ont augmenté de plus de 80% ! »
Quant au nombre de morts potentiellement évités, argument philanthropique s’il en est, Izoard n’y croit pas une seconde. Pour elle, sécuriser la route peut passer par d’autres moyens, comme multiplier les aménagements paysagers qui obligent à ralentir, ou encore les passages piéton. En définitive, l’autrice prévient ses lecteurs : le véhicule autonome ne fait que remettre à plus tard des décisions urgentes, et à « phagocyter toute réflexion pratique sur les politiques de transport en commun. »
Sa vraie utilité reste d’économiser sur la main d’œuvre, de soutenir un trafic croissant de camions, sans pour autant désenclaver le périurbain ou soi-disant aider les personnes âgées à se déplacer. Côté emploi, il n’y aurait pas grand-chose à y gagner souligne-t-elle, à part prolonger un mouvement d’automatisation qui risque de laisser un certain nombre de travailleurs sur le bas-côté. A-t-on envie de supprimer le travail de ceux qui conduisent ? « Réussir à emmener 50 personnes à bon port en toute sécurité, c’est un métier. Régler les conflits dans un bus, renseigner les gens perdus, réagir au panel de situations hautement improbables qui peuvent survenir dans le cours d’une journée, c’est un métier » Un métier ici réduit à sa dimension instrumentale – conduire – au détriment de toute une classe de travailleurs, humiliés par une autre classe de professionnels pour booster les profits de quelques multinationales. Acerbe, la journaliste avertit ses lecteurs ingénieurs : « la technologie que vous développez est l’instrument d’une guerre de classes. Une guerre silencieuse dans laquelle la bourgeoisie entrepreneuriale du numérique oeuvre, le plus souvent sans s’en rendre compte et en toute bonne conscience, contre la majorité des travailleurs et travailleuses. »
Les portes de sorties sont pourtant nombreuses, ne manque-t-elle pas de rappeler. Les ingénieurs qui font sécession sont nombreux (le livre termine avec une interview de l’un d’entre eux), et les projets alternatifs fleurissent, de l’Atelier Paysan (coopérative qui aide les agriculteurs à fabriquer de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne), aux initiatives plus localisées, comme ce « bus scolaire à pédale » expérimenté à Rouen pour le ramassage scolaire.
Dans la lignée de cette première lettre, deux textes suivent et s’adressent respectivement à Philippe Souères et Jean-Paul Laumond, tous deux directeurs de recherche en robotique au Laas-CNRS. Sur un même ton, Izoard interroge ces roboticiens et leur volonté de faire entrer des robots chez les personnes âgées, dans les hypermarchés (pour remplacer les caissières), ou encore dans les entrepôts. Quel sera l’impact sur ces travailleurs ? Cette quête d’automates est-elle exprimée par « la société », comme le prétendent parfois leurs concepteurs, ou par « des sociétés », celles pour qui ils travaillent et qui les financent ? Se rendent-ils seulement compte des implications sociales de leurs inventions ? En ré-encastrant l’automatisation du travail dans un conflit de classe, Izoard rappelle ce qui est malheureusement trop souvent vrai : « la capacité d’un chercheur à penser l’impact concret des technologies sur la vie des gens est proportionnelle aux distances sociales et physiques qui les séparent. » Ainsi, on ne s’interroge pas sur le nouveau rôle dévolu aux assistantes à domiciles, qui devront ajouter à leurs trajets non payés et à leur rémunération dérisoire, le soin de veiller à ce que les robots pour personnes âgées ne buggent pas. Tout comme nous n’interrogeons que trop peu la façon dont évolue le métier de caissière au contact des caisses automatiques, ou encore la capacité de tels objets à remettre sur la table le travail le dimanche et le travail de nuit.
La fin du travail quant à elle, se fait toujours attendre. A chaque génération de machines, on prétend dégager les travailleurs des effets néfastes suscités par les machines précédentes… « Quand admettra-t-on que l’automatisation totale n’est pas près d’exister, qu’il y aura longtemps de pauvres larbins coincés entre les machines d’hier et celles de demain ? Que le mythe des robots qui travailleront à notre place n’est que l’horizon en perpétuelle dérobade qui permet de rendre tolérable aujourd’hui la dégradation du travail humain par les machines ? »
Sans détour, le livre de Célia Izoard est punchy, réussi. Il laisse ouvertes certes, de grandes questions relatives au type de management dans les entreprises, qui joue pour beaucoup dans la conception et les conditions d’appropriation des outils. Il me semble néanmoins que l’essai a le mérite de ne pas céder à une forme de rejet du progrès technique sans concession – qui peut avoir son intérêt mais dans d’autres contextes, auprès d’autres lecteurs. J’ai particulièrement aimé les rappels sociologiques, sur la réalité du travail, du quotidien, de la vie des gens. Un effort que nous avons aussi voulu faire dans « Technologies partout, démocratie nulle part » en donnant à voir concrètement ce qu’est l’automatisation d’une caisse dans un supermarché. De ce point de vue, je vois une belle complémentarité entre nos essais. Izoard vise juste, précisément parce qu’elle n’enjoint pas les ingénieurs à tout abandonner, mais bien à interroger leurs pratiques, et leur éthique. Elle les sensibilise à des questions sociales, écologiques, économiques, et donc tout simplement politiques. Ceux-là ne ressortiront pas indemnes d’une telle lecture. A offrir donc, à tous vos copains ingénieurs – qu’on aime bien quand même.